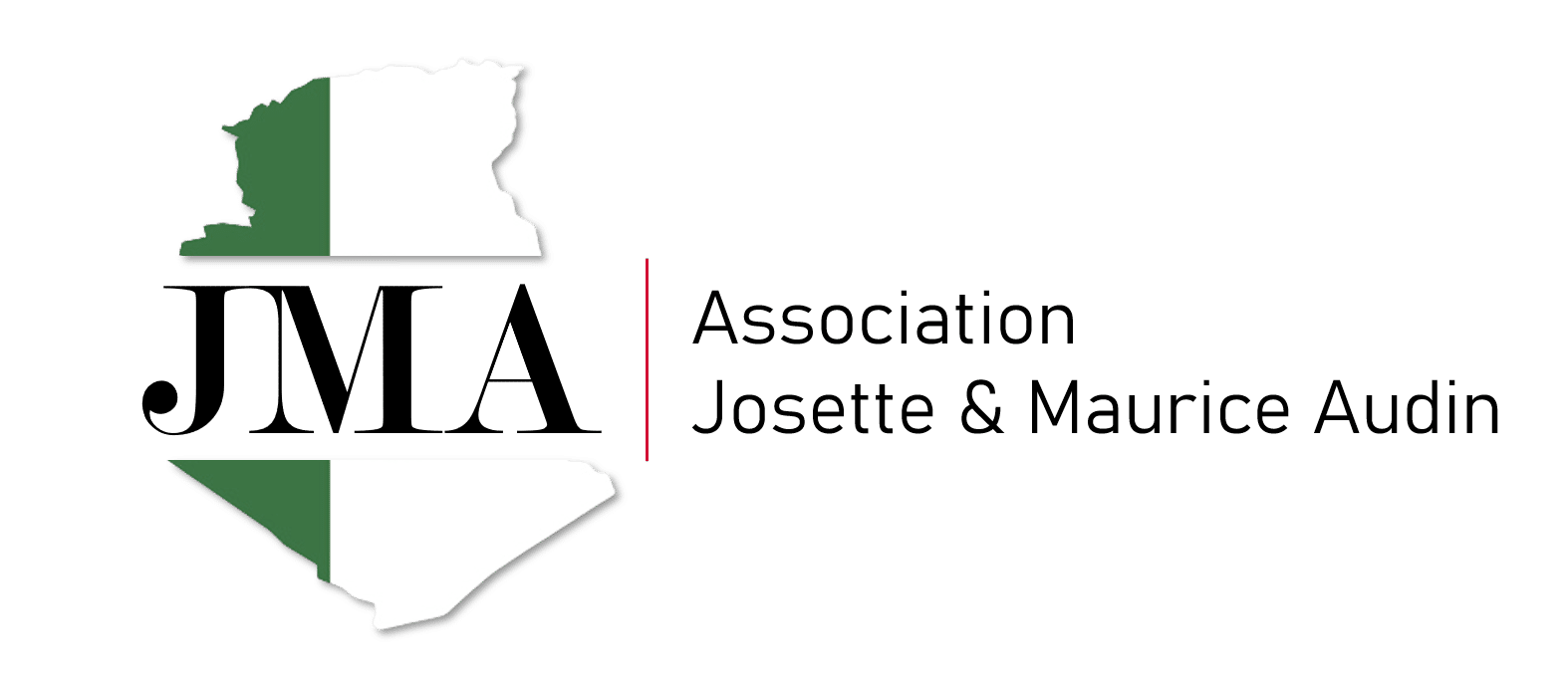Par FLORENCE BEAUGE
Le Monde 20 juin 2000
« J’étais allongée nue, toujours nue. Ils pouvaient venir une, deux ou trois fois par jour. Dès que j’entendais le bruit de leurs bottes dans le couloir, je me mettais à trembler. Ensuite, le temps devenait interminable. Les minutes me paraissaient des heures, et les heures des jours. Le plus dur, c’est de tenir les premiers jours, de s’habituer à la douleur. Après, on se détache mentalement, un peu comme si le corps se mettait à flotter. » Quarante ans plus tard, elle en parle avec la voix blanche. Elle n’a jamais eu la force d’évoquer avec sa famille ces trois mois qui l’ont marquée à vie, physiquement et psychologiquement. Elle avait vingt ans. C’était en 1957, à Alger. Capturée par l’armée française le 28 septembre, après être tombée dans une embuscade avec son commando, elle avait été transférée, grièvement blessée, à l’état-major de la 10e division parachutiste de Massu, au Paradou Hydra. « Massu était brutal, infect. Bigeard n’était pas mieux, mais, le pire, c’était Graziani. Lui était innommable, c’était un pervers qui prenait plaisir à torturer. Ce n’était pas des êtres humains. J’ai souvent hurlé à Bigeard : » Vous n’êtes pas un homme si vous ne m’achevez pas ! » Et lui me répondait en ricanant : « Pas encore, pas encore ! » Pendant ces trois mois, je n’ai eu qu’un but : me suicider, mais, la pire des souffrances, c’est de vouloir à tout prix se supprimer et de ne pas en trouver les moyens. » Elle a tenu bon, de septembre à décembre 1957. Sa famille payait cher le prix de ses actes de « terrorisme ». « Ils ont arrêté mes parents et presque tous mes frères et soeurs. Maman a subi le supplice de la baignoire pendant trois semaines de suite. Un jour, ils ont amené devant elle le plus jeune de ses neuf enfants, mon petit frère de trois ans, et ils l’ont pendu… » L’enfant, ranimé in extremis, s’en est sorti. La mère, aujourd’hui une vieille dame charmante et douce, n’avait pas parlé.
Sa fille aurait fini par mourir, dans un flot d’urine, de sang et d’excréments, si un événement imprévu n’était intervenu. « Un soir où je me balançais la tête de droite à gauche, comme d’habitude, pour tenter de calmer mes souffrances, quelqu’un s’est approché de mon lit. Il était grand et devait avoir environ quarante-cinq ans. Il a soulevé ma couverture, et s’est écrié d’une voix horrifiée : » Mais, mon petit, on vous a torturée ! Qui a fait cela ? Qui ? » Je n’ai rien répondu. D’habitude, on ne me vouvoyait pas. J’étais sûre que cette phrase cachait un piège. » Ce n’était pas un piège. L’inconnu la fera transporter dans un hôpital d’Alger, soigner, puis transférer en prison. Ainsi, elle échappera aux griffes de Massu, Bigeard et Graziani. Louisette Ighilahriz, « Lila » de son nom de guerre, retrouvera la liberté cinq ans plus tard, avec l’indépendance de l’Algérie. Depuis, elle recherche désespérément son sauveur. Ce souhait est même devenu une idée fixe, une obsession. « J’ai tout essayé, envoyé des messages partout, avec de moins en moins d’espoir de le retrouver vivant. S’il l’est encore, il doit avoir à peu près quatre-vingt-cinq ans. Je ne veux qu’une chose : lui dire merci. »
Elle ne sait presque rien de Richaud, sinon son nom, pour l’avoir entendu – mais elle n’est même pas sûre de l’orthographe -, sa fonction probable : médecin militaire, et son grade : commandant. A défaut de le revoir, Louisette Ighilahriz voudrait remercier sa fille : « Je me souviens qu’il m’avait dit : « Je n’ai pas vu ma fille depuis six mois, vous me faites terriblement penser à elle. » Alors, je la cherche, elle aussi. Je voudrais lui dire combien son père l’aimait et à quel point il pensait à elle, là-bas, en Algérie… »
FLORENCE BEAUGE