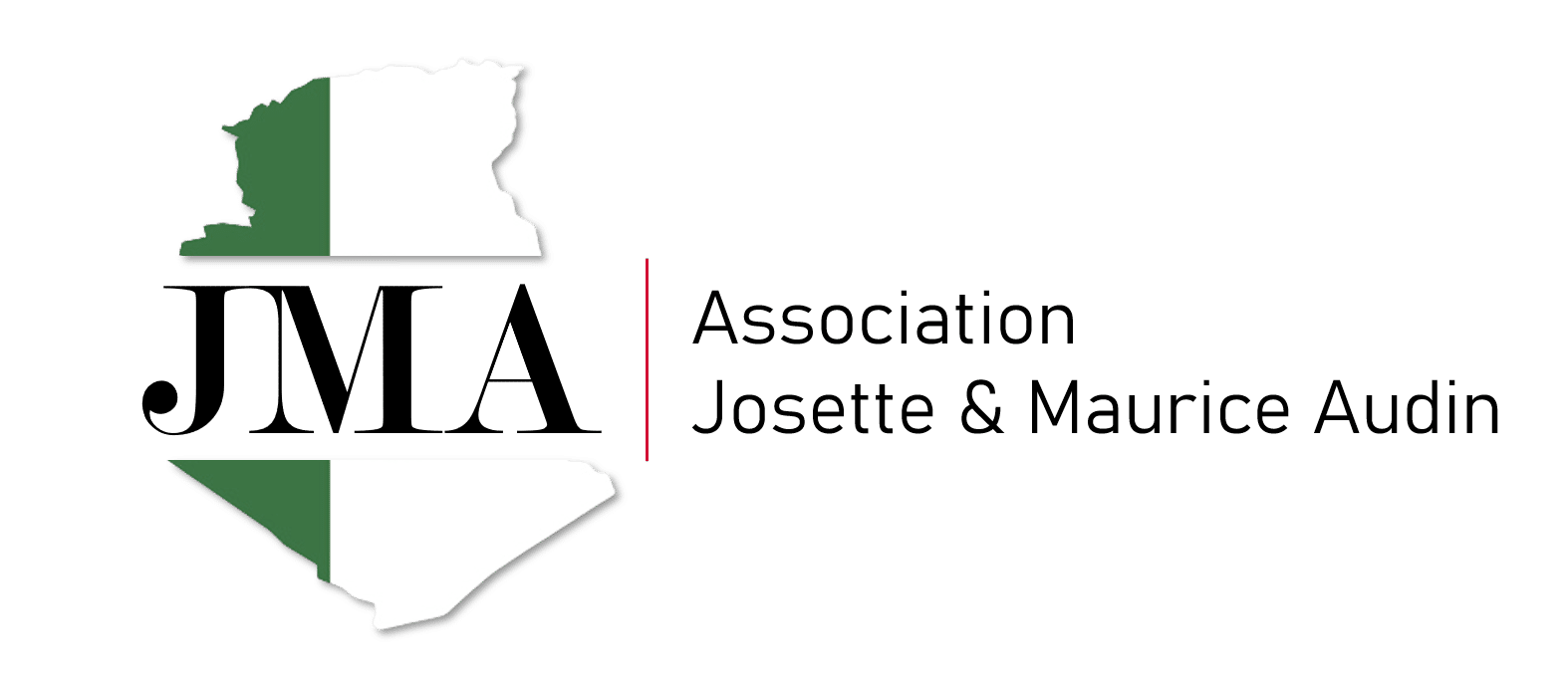Extraits du chapitre 7 d’Histoire de la guerre d’indépendance algérienne, Paris, Flammarion, 2005 (rééd. 2012)
Par Sylvie Thénault
La révélation de la torture
Depuis les attentats du Milk Bar et de la Cafétéria, le FLN a lancé l’offensive à Alger où, sous l’impulsion de Larbi Ben M’Hidi, une grève générale doit être déclenchée le 28 janvier 1957, alors que l’ONU s’apprête à examiner le cas algérien. Mais le général Massu, qui a reçu la responsabilité du maintien de l’ordre pour l’empêcher, usant de la force et de l’intimidation, parvient à faire échouer ce mot d’ordre du FLN. L’action terroriste, en revanche, pilotée par Yacef Saadi, se manifeste en deux temps forts : début février, les explosions au stade municipal d’Alger et au stade d’El Biar font dix morts et trente-quatre blessés ; en juin, l’attentat au Casino de la Corniche tue huit personnes et en blesse une centaine. L’arrestation de Yacef Saadi, le 24 septembre, suivie de la mort de son adjoint Ali La Pointe, le 8 octobre, consacre cependant le démantèlement de la Zone autonome d’Alger. Cette expérience est restée une tentative unique de structuration d’une ville comme secteur autonome du combat pour l’indépendance.
L’expression française « bataille d’Alger » désigne mal les opérations menées par les parachutistes, qui ne sont pas de nature strictement militaire. Du point de vue français, elle traduit bien, cependant, la dualité de la guerre conduite par l’armée en Algérie, entre combat et répression. Aucune expression alternative n’a d’ailleurs pu être proposée, à moins de se placer du point de vue algérien et de la désigner comme « la grande répression d’Alger[1] ».
Lieu et moment de l’élaboration d’un système répressif inconnu jusqu’alors, cette « bataille » s’accompagne d’un enchaînement d’affaires révélées par la presse qui, en l’espace d’une quinzaine de jours, en mars 1957, précipite la métropole dans la contestation de la manière dont est conduite la guerre en Algérie.
« SE TAIRE, C’EST ÊTRE COMPLICE »
Le 13 mars 1957, la sortie du livre de Pierre-Henri Simon, membre du Cercle des intellectuels catholiques, Contre la torture, aux éditions du Seuil, fait sauter les réticences de ceux qui craignaient de dénoncer la guerre. Pour Hubert Beuve-Méry, directeur du Monde, jusque-là le « dilemme » était « redoutable » : alors que, « témoins ou victimes d’atrocités commises en Algérie par des Français, des lecteurs s’affligent de la relative discrétion qu’observe Le Monde à ce sujet », il note, le jour même de la parution du livre, que « pour d’autres au contraire toute information qui peut être exploitée contre nous est déjà une trahison ». Mais, le convainquant que « se taire, c’est être complice », le livre balaie ses hésitations.
Cette prise de position, loin d’être isolée, est renforcée par les affaires qui surgissent au même moment. Le « suicide » de Larbi Ben M’Hidi, annoncé quelques jours avant la parution de Contre la torture, a été immédiatement mis en doute, notamment dans France-Observateur : « Bien qu’ayant eu les pieds et les poings liés pour éviter toute tentative d’évasion, le dirigeant nationaliste serait parvenu, selon M. Gorlin [porte-parole de Robert Lacoste] à confectionner une corde avec des lambeaux de sa chemise et à se pendre à un barreau de la fenêtre. » Les circonstances de la mort du chef historique du FLN, membre du CCE et responsable de la Zone autonome d’Alger, arrêté le 23 février, restent non élucidées : il aurait été pendu ou fusillé, avec ou sans les honneurs militaires, selon les témoignages[2].
Deux jours plus tard, une commission parlementaire, chargée d’enquêter sur une affaire de tortures datant de l’automne 1956, remet un rapport controversé, aussitôt publié par Le Monde. Le docteur Léon Hovnanian, lui-même membre de cette commission, dément en effet l’absence de « preuve valable » de sévices. S’« il est bien certain que, trois mois après les faits, il est difficile de vérifier l’existence de tortures, d’autant plus qu’on s’efforce d’employer des méthodes laissant le moins de traces possible », il a relevé des « contradictions » : « Par exemple, mettre sur le compte d’une épidémie d’eczéma [sic] les traces que l’on peut relever sur les mains et les pieds de certains détenus, est une explication qui peut difficilement être retenue par un médecin. » La contestation de ce rapport, dit rapport Provo, du nom du parlementaire socialiste qui dirige la commission d’enquête, occupe alors la presse, jusqu’à ce que, le 26 mars, le « suicide » de Me Ali Boumendjel, détenu par les parachutistes depuis le 9 février, soit annoncé.
Sa mort entraîne une série de protestations, dont celle de René Capitant, professeur de droit à la faculté d’Alger, dont Ali Boumendjel a été l’élève, qui suspend ses cours. Me Ahmed Boumendjel écrit au président de la République, René Coty, pour dénoncer le fait que son frère « était séquestré sous la responsabilité des pouvoirs publics qui lui devaient protection »[3]. Le lendemain, dans le même journal, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris condamne le « recours à des pratiques qui sont la négation des règles posées par nos codes pour prémunir les dépositions et les interrogatoires contre l’arbitraire et tout caractère occulte ». Par ailleurs, fin mars, le général Pâris de Bollardière informe l’opinion de sa démission, par l’intermédiaire de Jean-Jacques Servan-Schreiber, qui a servi sous ses ordres et dont il appuie les articles parus dans L’Express.
Le 5 avril est aussi publiée dans Le Monde une lettre écrite par le doyen de la faculté de droit d’Alger, Jacques Peyrega, au ministre de la Défense pour dénoncer une exécution sommaire dont il a été témoin trois mois plus tôt. Il ne veut pas, en effet, « être considéré plus longtemps comme complice ». Les parachutistes avaient arrêté un homme, même « s’il semblait assez difficile de le tenir avec certitude pour l’un des terroristes qui avaient pu être aperçus dix minutes auparavant à une centaine de mètres de là ». Le parachutiste qui le tenait « lui donnait un coup de genou dans le bas des reins et l’homme trébuchait et tombait sur les mains ». Considérant que « l’époque n’est plus à la sensiblerie en Algérie », le doyen n’est alors pas choqué, mais il est bouleversé par l’assassinat de l’homme, à quelques mètres de lui. « L’homme tombé était accroupi comme pour la prière, presque devant moi, un peu sur ma gauche : le parachutiste était toujours collé derrière lui, la mitraillette à la hauteur des reins de son prisonnier : deux petits coups secs claquèrent. »
Jacques Peyrega proteste cependant contre la publication de sa lettre qui, réalisée contre son gré, soulève les milieux universitaires algérois. Des étudiants organisent grève et manifestations contre lui. Ses collègues lui refusent leur soutien, certains l’accusent, dans Le Monde du 11 avril, de s’associer à « la campagne de dénigrement de l’armée française ». Malgré l’appui qu’il trouve à Paris où des professeurs signent une motion pour l’approuver, Jacques Peyrega doit abandonner son poste.
En mai, la nomination d’une Commission de sauvegarde des droits et libertés individuels, par le gouvernement de Guy Mollet, suspend l’engrenage des affaires. Il a pourtant fallu un mois au gouvernement, entre la décision de former cette Commission le 5 avril et sa première réunion le 10 mai, pour faire le choix très sensible de ses membres. Et son rôle est limité, car il est seulement prévu qu’elle « sera consultée chaque fois qu’un fait pouvant constituer un abus parviendra […] aux autorités », même si elle « pourra aussi donner son avis spontanément[4] ». Sous la direction de Pierre Béteille, ses membres se lancent rapidement dans diverses enquêtes : Charles Richet et Henri Zeller visitent des camps d’internement, Robert Delavignette étudie l’action des militaires, à la fois des « exactions » et les SAS, tandis que Maurice Garçon se charge des sévices et des disparitions[5].
Cependant, le massacre dit « de Melouza » et la relance des attentats à Alger en juin supplantent les critiques envers l’armée. La dénonciation des horreurs de la guerre tend désormais à se faire sur deux fronts, renvoyés dos à dos, comme en témoigne la déclaration d’un ancien sénateur, Mohammed Kessous, rapportée par Le Monde le 11 juin : « Alors que tant de Français de souche condamnent courageusement ceux des leurs qui commettent des atrocités dans nos villes et nos campagnes, tout musulman bien né leur fera écho en condamnant avec une fermeté égale ceux des siens qui souillent par des gestes criminels la cause de la liberté en prétendant la défendre. » La presse choisit également l’attentisme après la chute du gouvernement de Guy Mollet : quelles réponses apportera son successeur aux dénonciations de ces violences ?
Les six derniers mois de l’année 1957 voient éclater les affaires Alleg et Audin. Tous deux membres du PCA, ils ont été arrêtés en juin par les parachutistes ; en août, Gilberte Alleg et Josette Audin, inquiètes pour leurs maris, décident d’alerter l’opinion métropolitaine. La personnalité même d’Henri Alleg, ancien directeur d’Alger Républicain, aide à la médiatisation de son cas. Les 6 et 7 août, ses avocats dénoncent le fait qu’ils n’ont pas encore pu voir leur client qui, interné au camp de Lodi, ne peut recourir aux services de défenseurs. Le 21 août, enfin, Henri Alleg est présenté au capitaine Missoffe, juge d’instruction militaire au tribunal permanent des Forces armées d’Alger, qui l’inculpe pour reconstitution de ligue dissoute et atteinte à la sûreté extérieure de l’État.
Le cas de Maurice Audin mobilise les milieux universitaires, qui créent un Comité portant son nom, pour « la recherche de la vérité dans l’affaire Audin et la dénonciation de la torture[6] ». Ses membres, parmi lesquels Laurent Schwartz, Luc Montagnier, Madeleine Rebérioux ou encore Michel Crouzet, représentent « toutes les professions universitaires » ainsi que « toutes les sensibilités politiques de gauche[7] ». La soutenance du doctorat d’État de Maurice Audin, organisée en son absence à la Sorbonne, le 2 décembre 1957, crée aussi l’événement.
Au même moment, la presse entretient une polémique autour des travaux de la Commission de sauvegarde. En effet, les successeurs de Guy Mollet, Maurice Bourgès-Maunoury et Félix Gaillard, promettent, sans s’exécuter, la publication du rapport synthétisant les travaux de ses membres. Début octobre, deux d’entre eux, Robert Delavignette et Maurice Garçon, démissionnent pour dénoncer le fait que leurs enquêtes n’ont « reçu aucune suite[8] ». Finalement, le 14 décembre, Le Monde rend public le rapport de la Commission, qui étudie les « violences », « tortures », « conditions dans lesquelles sont intervenues les mesures d’internement » ainsi que, dans un court paragraphe, les conditions de détention dans les centres de triage, les « centres d’hébergement », les établissements pénitentiaires et hospitaliers. La Commission a gardé pour la fin les disparitions, sujet d’actualité depuis que les affaires Alleg et Audin ont émergé. Sa conclusion est empreinte à la fois de réalisme et de pessimisme : « La Commission ne peut aller plus loin. De nouveaux rapports ne seraient que la répétition des neuf qu’elle a déjà déposés. C’est au gouvernement et à lui seul qu’il incombe maintenant de prendre des décisions. »
Seules les affaires Alleg et Audin se prolongent jusqu’à la chute de la IVe République, par la parution de livres. En février 1958, aux Éditions de Minuit, La Question rend public le récit de son supplice par Henri Alleg. Comble de l’absurdité, le gouvernement de Félix Gaillard décide de le saisir, alors que soixante-cinq mille exemplaires en ont déjà été diffusés. En mai, enfin, paraît L’Affaire Audin, de Pierre Vidal-Naquet, qui, disséquant les faits, démontre que Maurice Audin ne s’est pas évadé, comme le prétend la version officielle.
L’année 1957 a été celle d’une prise de conscience collective en métropole. La peur de passer pour un traître, qui muselait les esprits, cesse sous l’avalanche des preuves de la pratique de la torture, des exécutions sommaires et des disparitions. Jusque-là, en effet, les affaires dénoncées étaient restées sans suite.
(…)
LE GOUVERNEMENT ET LES « EXACTIONS »
Le gouvernement de Guy Mollet organise sa contre-offensive en médiatisant les atrocités du FLN et en imitant ses prédécesseurs par les saisies, les poursuites judiciaires et la nomination d’une commission d’enquête, qui vient tempérer ses premières dénégations.
Le 1er mars 1957, en effet, Guy Mollet a mis en doute les « prétendus témoignages écrits » et les « lettres reçues » par la presse, au motif que ces documents ne lui ont pas été communiqués[9]. Le 15 mars, cependant, le ministre de la Défense, Maurice Bourgès-Maunoury, admet « quelques exactions », qui « ont été réprimées par le commandement[10] ». La formation de la Commission de sauvegarde entérine cette reconnaissance d’« exactions », dont la sanction est régulièrement réaffirmée. Il n’existe « aucune exaction connue qui n’ait été punie[11] », déclare Robert Lacoste en mai ; puis en décembre : « Chaque fois que j’ai été saisi d’un cas précis, une sanction sévère a été prononcée. » Il en donne même un décompte : « 495 punitions ont été prononcées par les autorités responsables, dont 363 cas passibles des tribunaux militaires[12]. » Il s’appuie sur les travaux d’une commission interne à l’armée, présidée par le colonel Thomazo, connu pour être, dès 1957, lié aux milieux activistes algérois. Or, cette commission a surtout recensé des vols, des viols et des délits de droit commun qui, effectivement, ont été punis. Mais il ne s’agit pas, sauf dans quelques cas, de torture ou d’exécutions sommaires[13]. Robert Lacoste profite du glissement sémantique de « torture », « exécutions sommaires » vers le terme plus flou d’« exactions », pour mentir.
Il répond aussi par les atrocités du FLN. « Examiner possibilité faire faire par combattants brochure fortement illustrée : où sont les tortionnaires ? Nécessité agir à fond et sans ménagement dans la voie de la riposte aux salauds que vous savez », exige-t-il dans un télégramme envoyé le 27 mars 1957, en pleine tourmente médiatique, à Pierre Gorlin, son conseiller chargé de l’Information[14]. C’est ainsi que la brochure Aspects véritables de la rébellion algérienne est éditée juste après le massacre « de Melouza », qui vient conforter le ministre résidant. Le Monde publie d’ailleurs de larges extraits de cette brochure, pour faire pendant au rapport de synthèse de la Commission de sauvegarde, le 14 décembre 1957. Pourtant, l’invocation des violences du FLN est vaine, les opposants à la torture insistant sur le déshonneur de l’armée et de la France, qui ainsi s’avilirait : « Cette “sale guerre” qui nous est imposée, il dépendait de nous que, de notre côté, elle demeurât à peu près propre », argumente Pierre-Henri Simon[15].
En outre, le gouvernement tente d’intimider la presse et les éditeurs par des saisies à répétition. Pratiqué pendant toute la guerre d’indépendance algérienne, ce procédé, plus pernicieux que la censure, suscite l’autocensure des journalistes, soucieux d’éviter de lourdes pertes financières. Alors que la censure vérifie le contenu avant l’impression, la saisie consiste à confisquer le journal au stade de la diffusion des exemplaires imprimés, qui ont donc été fabriqués à perte. Jérôme Lindon, directeur des Éditions de Minuit, relate d’ailleurs qu’il a pallié le refus de la presse de publier certains récits[16]. Dans cet esprit aussi, naît une presse clandestine diffusée sous le manteau, qui reprend systématiquement les textes visés : Témoignages et documents, lancé par Maurice Pagat et Robert Barrat en 1957, puis, à partir de 1959, Vérité-Liberté, édité par le Comité Maurice Audin.
Sur l’ensemble de la guerre, les trois quarts des saisies de presse ont concerné la torture, les exécutions sommaires et les conditions de détention dans les prisons ou les camps ; pour le reste, il s’agit de manifestes politiques, d’extrême droite ou d’extrême gauche, de textes relatifs à l’objection de conscience ou à la désertion, d’interviews de nationalistes ou d’activistes et, enfin, d’attaques contre le chef de l’État, l’armée et les pouvoirs publics[17]. La saisie, cependant, n’obère pas la circulation des informations, d’autant que, parfois, celles-ci figurent dans d’autres journaux, qui ne sont pas visés. Mais elle fait planer une menace redoutable sur les titres les plus fréquemment touchés, en métropole et en Algérie : Témoignage chrétien, France-Observateur, L’Express, La Croix, L’Humanité, Le Monde, sans compter Alger Républicain ou L’Espoir-Algérie, qui disparaissent.
Les poursuites judiciaires ne sont pas non plus l’exclusivité du gouvernement de Guy Mollet, même s’il en use en 1957, notamment contre Georges Montaron, directeur de Témoignage chrétien, après la publication du Dossier Jean Müller, ou contre Jean-Jacques Servan-Schreiber, inculpé pour son récit dans L’Express. Déclenchées par des plaintes du ministère de la Défense, ces poursuites suscitent de telles réactions qu’elles ne dépassent pas le stade de l’inculpation. Elles s’accompagnent cependant de perquisitions, voire d’une incarcération. Robert Barrat en a été la première victime, après avoir publié une interview d’Abbane Ramdane et d’Amar Ouamrane dans France-Observateur le 15 septembre 1955, sous le titre « Un journaliste français chez les “hors-la-loi” algériens ». Arrêté à son domicile et emprisonné, il est libéré au bout de quelques jours devant l’ampleur des protestations[18]. En avril 1956, Claude Bourdet subit le même sort, pour une série d’articles relatifs à l’Algérie dans France-Observateur. Henri-Irénée Marrou est lui aussi victime d’une perquisition pour « participation à une entreprise de démoralisation de l’armée », après avoir dénoncé dans « France, ma patrie », paru dans Le Monde du 5 avril, les camps, les représailles collectives et les tortures policières. En mai, la journaliste de l’hebdomadaire Demain, Claude Gérard, auteur de « Comment j’ai vu le maquis », est écrouée à la Petite Roquette. André Mandouze, directeur de Consciences maghrébines, où il reproduit des textes du FLN, est inculpé d’atteinte à la sûreté de l’État et emprisonné à la Santé en novembre. C’est cette dernière affaire, d’ailleurs, qui suscita l’engagement de Pierre Vidal-Naquet contre la guerre[19].
DES MILITANTS CONTRE LA GUERRE
Les victimes de ces poursuites forment un panel partiellement représentatif des intellectuels opposés à la guerre. Anciens résistants, souvent d’obédience chrétienne et indépendants des organisations de gauche, ils se rattachent à des courants qui se sont structurés autour d’une publication : André Mandouze et Robert Barrat à Témoignage chrétien, Jean-Marie Domenach et Henri-Irénée Marrou à Esprit, Claude Bourdet à Combat, où a également été Claude Gérard, puis à France-Observateur avec Gilles Martinet. L’opposition à la guerre d’Algérie réactive des réseaux tissés dans la Résistance ou dans l’opposition à la politique coloniale française en Indochine, à Madagascar, en Afrique, au Maroc… L’itinéraire et les relations des avocats dans les milieux de la gauche parisienne, en particulier, le révèlent : Pierre Stibbe, par exemple, a défendu les parlementaires malgaches traduits en justice après la répression de l’insurrection de 1947, et il est membre de la direction de l’hebdomadaire France-Observateur.
Cette opposition reconduit également des modes d’action et d’organisation éprouvés avant 1954. Professionnels de l’écriture, jouissant d’une notoriété certaine, ces hommes ont appris à manier avec talent l’arme de la publication et des déclarations publiques de protestation. Pour se rassembler, ils privilégient la formule du comité indépendant de tout parti politique, sur le modèle, notamment, du Comité France-Maghreb, fondé en 1953 en solidarité avec les nationalistes marocains, où se retrouvaient, entre autres, Robert Barrat, François Mauriac et Claude Bourdet. Ils fondent le Comité des intellectuels contre la poursuite de la guerre en Afrique du Nord qui, dès le 27 janvier 1956, organise un meeting où Jean-Paul Sartre, André Mandouze, Robert Barrat et Daniel Guérin, notamment, prennent la parole. Cependant, seule la défense des droits de l’homme les réunit par-delà leurs divergences. Au contraire, le choix entre FLN et MNA les déchire, après la parution de L’Algérie hors la loi au Seuil, fin 1955, par lequel Francis et Colette Jeanson, qui militent au Comité, s’engagent pour les Frontistes[20].
La contestation gagne aussi l’intérieur des partis de gauche. À la SFIO, une minorité s’est affirmée contre la politique coloniale française depuis la fin des années 1940 et elle s’active contre Guy Mollet en 1956. S’y retrouvent notamment Daniel Mayer, président de la Ligue des droits de l’homme, opposé aux exécutions capitales, Robert Verdier, en désaccord avec les pouvoirs spéciaux, ou encore Alain Savary, qui démissionne du gouvernement à l’automne 1956. Au nom de cette minorité persévérante qui va d’ailleurs se détacher de la SFIO, André Philip dépose une motion pour la paix au congrès du mois de juillet, la même année.
Quant au PCF, son soutien aux pouvoirs spéciaux suscite un mécontentement chez des militants qui, localement, n’ont pas craint de produire leurs propres tracts ou brochures dénonçant la loi. Les formulations utilisées par la direction du PCF, comme le slogan prônant « La paix en Algérie », recèlent par ailleurs suffisamment d’ambiguïté pour que des militants les extrapolent, en toute bonne foi, comme synonymes d’une prise de position favorable à l’indépendance. La contestation de la ligne communiste est appelée à grandir parmi les jeunes recrues, qui sont invitées à partir en Algérie pour y mener un travail militant à l’intérieur de l’armée. À Alger, de septembre 1955 à février 1957, Lucien Hanoun, aidé par Alfred Gerson, un métropolitain spécialiste de ces questions, dirige pour le PCA un réseau chargé d’éditer et de diffuser La Voix du soldat, publication d’une ou deux pages tirée à quelques centaines d’exemplaires. Le contingent y est appelé à « prolonger sur le sol algérien la lutte de la classe ouvrière et du peuple français pour la paix et l’indépendance, pour l’amitié entre le peuple algérien et le peuple français[21] ». Il n’est question ni de désertion, ni d’insoumission. Militant communiste, Alban Liechti agit seul lorsqu’il écrit au président de la République le 2 juillet 1956 : « Je ne peux pas prendre les armes contre le peuple algérien en lutte pour son indépendance[22]. » Persistant dans ses positions en Algérie, il est condamné à deux ans de prison en novembre 1956, mais L’Humanité ne fait campagne pour sa libération qu’en septembre 1957.
Reposant sur divers fondements, la contestation de la guerre est antérieure à l’année 1957 et dépasse la seule dénonciation de la torture. Mais cette dénonciation, impératif moral transcendant les clivages politiques, amplifie l’opposition à la guerre à partir du printemps 1957, et soude des militants venus d’horizons divers, dont le Comité Maurice Audin est emblématique. Le choix entre le MNA et le FLN ou l’approbation de l’insoumission et de la désertion, en revanche, créent des divergences restées indépassables jusqu’à la fin du conflit. Le retour au pouvoir du général de Gaulle en mai 1958 va lancer une pomme de discorde supplémentaire.