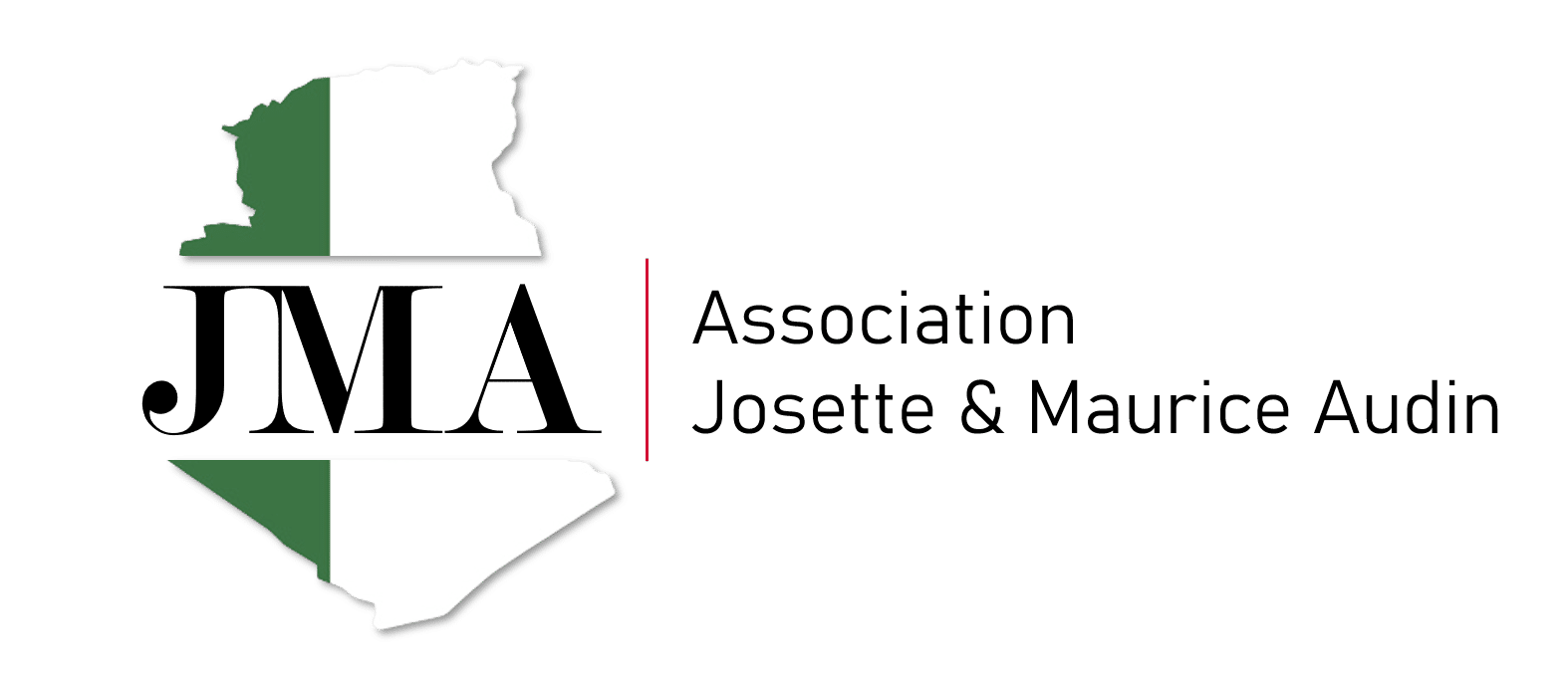En juin 2000, un article racontant le calvaire de Louisette Ighilahriz, entraîne un retour de mémoire inattendu. Massu regrette… Aussaresses avoue…
Le Monde _Florence Beaugé
Publié le 17 mars 2012
Sans l’histoire de Louisette Ighilahriz, racontée à la « une » du Monde le 20 juin 2000, le retour de mémoire des années 2000 sur la guerre d’Algérie n’aurait pas eu lieu. Ce jour-là paraît un court récit en forme de coup de poing. « J’étais allongée nue, toujours nue. Ils pouvaient venir une, deux ou trois fois par jour. Dès que j’entendais le bruit de leurs bottes, je me mettais à trembler. Ensuite, le temps devenait interminable. Les minutes me paraissaient des heures, et les heures des jours. Le plus dur, c’est de tenir les premiers jours, de s’habituer à la douleur. Après, on se détache mentalement. C’est un peu comme si le corps se mettait à flotter… » Louisette Ighilahriz avait 20 ans quand elle s’est retrouvée, grièvement blessée, dans les locaux de la 10e division parachutiste (DP) à Alger, en septembre 1957, après un accrochage avec l’armée française. Pendant sa captivité, elle voit passer de temps à autre Massu et Bigeard, deux des plus hauts responsables militaires de l’époque. C’est un de leurs adjoints, le capitaine Graziani, qui est chargé de l’interroger. Ce pied-noir n’utilise ni la gégène ni le supplice de l’eau pour faire parler sa prisonnière. Il la viole.
Si Louisette Ighilahriz sort de l’enfer au bout de trois mois, c’est grâce à un inconnu, un certain commandant Richaud. Quand cet officier – le médecin militaire de la 10e DP – découvre l’état dans lequel elle est, il s’émeut. « Vous me faites penser à ma fille », lui dit-il, avant d’ordonner son transfert à l’hôpital, puis en prison. Louisette n’oubliera jamais cet inconnu dont elle ne connaît que le nom. Toute sa vie, elle rêvera de le retrouver pour lui dire merci. Quand elle se confie au Monde en avril 2000 à Alger, c’est dans l’espoir de le revoir. En imaginant qu’il soit toujours vivant.
Le général Bigeard à Toul, en février 2008. AFP/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
L’article, sitôt publié, soulève une émotion considérable. Bigeard menace le journal d’un procès « qui le mettra à genoux » et qualifie le récit de Louisette Ighilahriz de « tissu de mensonges ». « Le commandant Richaud, prétend-il, n’a existé que dans l’imagination de l’ancienne combattante algérienne. » Contre toute attente, c’est le général Massu qui va donner du crédit à cette histoire. « Richaud était l’un de mes bons amis, un homme de grande qualité, un humaniste mais il est mort il y a deux ans », révèle-t-il.
Plus inattendu encore : au cours de cette interview accordée au Monde, Massu avoue que la torture « n’est pas indispensable en temps de guerre » et que l’on pourrait « très bien s’en passer ». « Quand je repense à l’Algérie, cela me désole. La torture faisait partie d’une certaine ambiance. On aurait pu faire les choses différemment », ajoute-t-il. Les « regrets » de Massu créent la stupeur. S’ajoutant à l’histoire de Louisette Ighilahriz, ils déclenchent un « retour du refoulé » sur la guerre d’Algérie auquel personne ne s’attendait. « Jamais je n’aurais cru assister à cela de mon vivant », déclare, bouleversé, l’historien Pierre Vidal-Naquet.
Le général Jacques Massu (2-ème G) s’entretient le 26 novembre 1958 au sud de Palestro, en Algérie, avec les généraux Jacques Faure (D) et Maisonrouge (G) lors d’une opération militaire engagée contre les maquis FLN. AFP
Le Monde décide alors de poursuivre son travail de mémoire, en privilégiant la parole côté algérien. Les reportages s’enchaînent. Le 9 novembre 2000, sort l’histoire de Khéïra Garne, qui vit dans un cimetière d’Alger, entre deux tombes, à demi folle. Khéïra avait 15 ans quand elle a été victime d’un viol collectif commis par des soldats français, à Theniet El-Had, au sud-ouest d’Alger. De ce drame, elle a eu un fils, Mohamed. Cet homme, qui se dit « français par le crime », ne cherche pas à identifier son père – « pour moi, un treillis vide, les yeux vides », dit-il sèchement – mais à faire reconnaître par l’administration française le préjudice qu’il a subi. Il réclame une pension en tant que victime de guerre, souffrant de troubles psychiques. Mais le ministère de la défense la lui refuse, au motif qu’il n’est pas une victime de la guerre d’Algérie puisqu’il en est… le fruit !
« SANS REGRETS NI REMORDS »
L’histoire de Khéïra et Mohamed Garne sera le prélude à une autre enquête du Monde, cette fois-ci sur les viols commis par l’armée française pendant la guerre d’Algérie. Non, les viols n’ont pas été de simples « dérapages » mais ont eu un caractère massif… Cette « découverte-redécouverte » de la guerre d’Algérie prend une tournure plus politique à partir du 31 octobre 2000, avec l’appel des douze. A l’initiative de L’Humanité, douze grands témoins, parmi lesquels Henri Alleg et Pierre Vidal-Naquet, qui avaient pris à la fin des années 1950 un engagement de premier plan, invitent l’Etat français à « promouvoir une démarche de vérité qui ne laisse rien dans l’ombre ».
Le général Paul Aussaresses, le 06 juillet 2001, dans la salle d’audience du tribunal correctionnel de Paris. AFP/JOËL ROBINE
C’est dans ce contexte que le général Aussaresses sort de l’ombre pour la première fois. Dans une longue interview publiée par Le Monde le 23 novembre 2000, le coordinateur des services de renseignements à Alger en 1957 dévoile les secrets de la « Grande Muette ». Pourquoi parle-t-il, à 82 ans ? Non parce que sa mémoire le tourmente, mais parce qu’il s’ennuie. Il a trouvé une oreille pour l’écouter. Pendant deux mois, le vieux général à l’œil bandé – une opération de la cataracte qui a mal tourné – vient au journal, alors installé rue Claude-Bernard. Autour d’un café, il raconte sa vie. Informels, ces entretiens se transformeront en interview.
L’homme est complexe. Cultivé – ancien khâgneux, il a soutenu un mémoire sur la place du merveilleux dans l’œuvre de Virgile – mais usant d’un langage souvent sommaire, il n’en est pas à un paradoxe près. Cet inconditionnel du général de Bollardière, célèbre militant contre la torture, avoue « sans regrets ni remords » avoir torturé en Algérie et procédé lui-même à des exécutions sommaires. Il n’est plus question de « bavures » mais de la reconnaissance d’un système. C’est la première fois qu’un haut gradé français l’admet, et même s’en vante. Quatre mois plus tard, Aussaresses ira encore plus loin dans un livre (Services spéciaux, Algérie 1955-1957, Plon-Perrin) – en réalité la retranscription de ses souvenirs confiés au service historique de l’armée de terre (SHAT), qui l’a contacté au lendemain de ses premiers aveux. Le vieux général revendique l’exécution, en 1957 à Alger, d’Ali Boumendjel, célèbre avocat engagé auprès du FLN, et celle de Larbi Ben M’Hidi, « le Jean Moulin algérien ».
AUX MARCHES DE L’ELYSÉE
Pour avoir jeté un pavé dans la mare, Paul Aussaresses sera dégradé de la Légion d’honneur, en 2005, par Jacques Chirac. « On m’a puni pour ce que j’ai dit, pas pour ce que j’ai fait », rumine, aujourd’hui encore, cet ancien héros de la France libre, dans le petit village proche de Strasbourg où il habite avec sa femme.
Ce même 23 novembre 2000, paraît dans Le Monde une nouvelle interview du général Massu. Ce sera la dernière qu’il accordera avant sa mort, deux ans plus tard. « La torture est quelque chose de moche. C’est un engrenage dangereux, déclare-t-il. Institutionnaliser la torture, je pense que c’est pire que tout ! » C’est la première fois que des acteurs de la guerre d’Algérie, et non des moindres, reconnaissent publiquement ce que des intellectuels, des journalistes, des historiens, se sont évertués à faire savoir dans les années 1950. L’important n’est pas tant ce que disent Massu et Aussaresses, mais le fait que ce sont eux qui le disent.
Le 21 avril 2002, la France découvre, entre stupeur et tremblements, que Jean-Marie Le Pen est aux marches de l’Elysée. Le leader du Front national a éclipsé au premier tour de l’élection présidentielle le candidat socialiste, Lionel Jospin, et se retrouve en lice pour le second tour avec le président sortant, Jacques Chirac. Le Monde s’estime alors en droit de passer outre les lois d’amnistie qui imposent le silence sur la torture et de révéler le passé du président du Front national. Jeune député poujadiste, engagé volontaire en Algérie, Jean-Marie Le Pen a contribué à mettre en œuvre la « torture à domicile », au premier trimestre 1957.
L’enquête du Monde sort en deux temps. Le 4 mai 2002, à l’avant-veille du second tour de la présidentielle, paraît « l’affaire du poignard » : une nuit d’horreur à la Casbah d’Alger, durant laquelle un indépendantiste algérien, Ahmed Moulay, est torturé devant sa femme et ses six enfants par une vingtaine de parachutistes français conduits par un homme grand, blond, fort, que tout le monde appelle « mon lieutenant ». Quelques semaines plus tard, la photo de cet homme apparaît à la » une « de la presse algéroise. La famille Moulay a un choc. L’homme est au garde-à-vous devant le général Massu, qui lui remet la Légion d’honneur. Son nom s’étale en toutes lettres : Jean-Marie Le Pen.
Quand les parachutistes quittent la maison des Moulay à l’aube du 3 mars 1957, après avoir achevé le père d’une rafale de mitraillette, ils oublient sur place un poignard. Mohamed Cherif, 12 ans, l’un des enfants du supplicié, s’en empare et le cache. Sur le fourreau de l’arme, on peut lire l’inscription : JM Le Pen, 1er REP.
La seconde partie de l’enquête du Monde sort le 4 juin 2002, peu avant le premier tour des élections législatives. Il s’agit du témoignage de quatre anciens combattants algériens – Abdelkhader Ammour, Mustapha Merouane, Mohamed Amara et Mohamed Abdellaoui – qui accusent nommément Jean-Marie Le Pen de tortures à Alger, en 1957. Cette seconde « salve » fait réagir le prétendant à l’Elysée. Le leader d’extrême droite convoque une conférence de presse à Paris pour dénoncer une « machination immonde » et annoncer qu’il entame une procédure en justice contre Le Monde.
Une année s’écoule. Le 26 juin 2003, la 17e chambre valide l’enquête du journal et la qualifie de « particulièrement sérieuse et approfondie ». Par son ampleur exceptionnelle, – 50 pages – le jugement est de poids. Le tribunal reconnaît « la bonne foi » du journal et sa légitimité à « informer ses lecteurs sur des circonstances qui lui paraissent dignes d’intérêt et offrant une crédibilité certaine ». Le président du FN est donc débouté de sa plainte en diffamation. Mais il fait appel. Le 6 octobre 2004, la cour d’appel confirme en tous points le jugement de première instance. Le Pen est à nouveau débouté. Son pourvoi en cassation est rejeté.
De l’autre côté de la Méditerranée, les Algériens suivent avec passion et émotion le débat qui agite la France depuis juin 2000. Un à un, les « témoins humiliés de l’ombre » – selon l’expression de Paul Teitgen, secrétaire général de la préfecture d’Alger, qui s’opposa à Massu – relèvent la tête. C’est ainsi que le général Schmitt se retrouve pris à son propre piège à l’automne 2004. Alors qu’il dénonce les tortures commises à Abou Ghraib, en Irak, par l’armée américaine, une certaine Esmeralda sort du silence.
Dans un petit livre titré Un été en enfer (Editions Exils), elle dévoile le passé de tortionnaire de celui qui, bien avant de devenir le chef d’état-major des armées françaises, a dirigé l’un des plus célèbres centres d’interrogatoires d’Alger : l’école Sarouy. Bien qu’inédit, le récit d’Esmeralda n’a pas été reconstruit postérieurement, ce qui lui donne d’autant plus de force. Le manuscrit originel figure en effet dans les archives de l’année 1957 d’Hubert Beuve-Méry, le fondateur du Monde. Le journal, qui dispose depuis plusieurs années d’informations sur le général Schmitt, décide alors de relancer son enquête.
Le 19 mars 2005, Le Monde publie les témoignages de cinq anciens combattants algériens, Lyès Hani, Mouloud Arbadji, Mohamed Bachali, Zhor Zerari et Rachid Ferrahi. Ces témoins désignent le général Schmitt, lieutenant à l’époque, comme « chef d’orchestre de leurs tortures ». L’un d’eux précise : « Il jouissait particulièrement quand l’un de nous était humilié. » Sollicité pour donner sa propre version des événements, le général Schmitt décline la proposition du Monde mais accepte celle de France Inter. A la radio, l’ancien chef d’état-major dément avec indignation ces accusations de tortures et parle de « pure affabulation » et de « vengeance tardive » de la part d’Algériens qui veulent faire parler d’eux.
Avec cette enquête sur le général Schmitt se referme le retour de mémoire des années 2000 sur la guerre d’Algérie. Fatigue. Usure… Le Monde choisit de s’arrêter là. Le couvercle retombe en France. En Algérie, en revanche, le débat se poursuit de façon chaotique, entre deux tentatives de récupération par le pouvoir politique.
Les uns après les autres, les survivants algériens disparaissent sans avoir obtenu ce qu’ils réclament depuis un demi-siècle : non pas une « repentance » comme on l’imagine à tort mais la reconnaissance solennelle, par la France, de ce qu’ils ont subi. Ils ne crient pas vengeance, n’espèrent aucune compensation financière. Ils veulent seulement qu’on dise la torture, les déportations, les regroupements de populations, les viols, les exécutions sommaires… Qu’on cesse, surtout, de renvoyer dos à dos le FLN et l’armée française. Qu’on ne prétende plus que la torture a été employée « pour sauver des vies innocentes » alors qu’elle était pratiquée de façon routinière dès le début de la colonisation, donc bien avant le soulèvement de 1954 et les attentats à la bombe commis par le FLN. Les Algériens ont besoin que l’on mette des mots sur leurs souffrances. Le pardon est possible, mais pas le déni. Si la France accepte un jour de regarder son passé en face et de l’assumer, alors les Algériens tourneront pour de bon cette page noire, au lieu de la ressasser encore et encore, dans la douleur.
—
1- Dans Le Monde du 23 novembre 2000, le général Massu « regrette », le général Aussaresses admet qu’il y a eu emploi de la torture, voire s’en vante.
2- Après ses aveux, le général Aussaresses sera dégradé de la Légion d’honneur par le président Jacques Chirac, en 2005.
Cet article est tiré du Hors-Série du Monde : « Guerre d’Algérie. Mémoires parallèles »