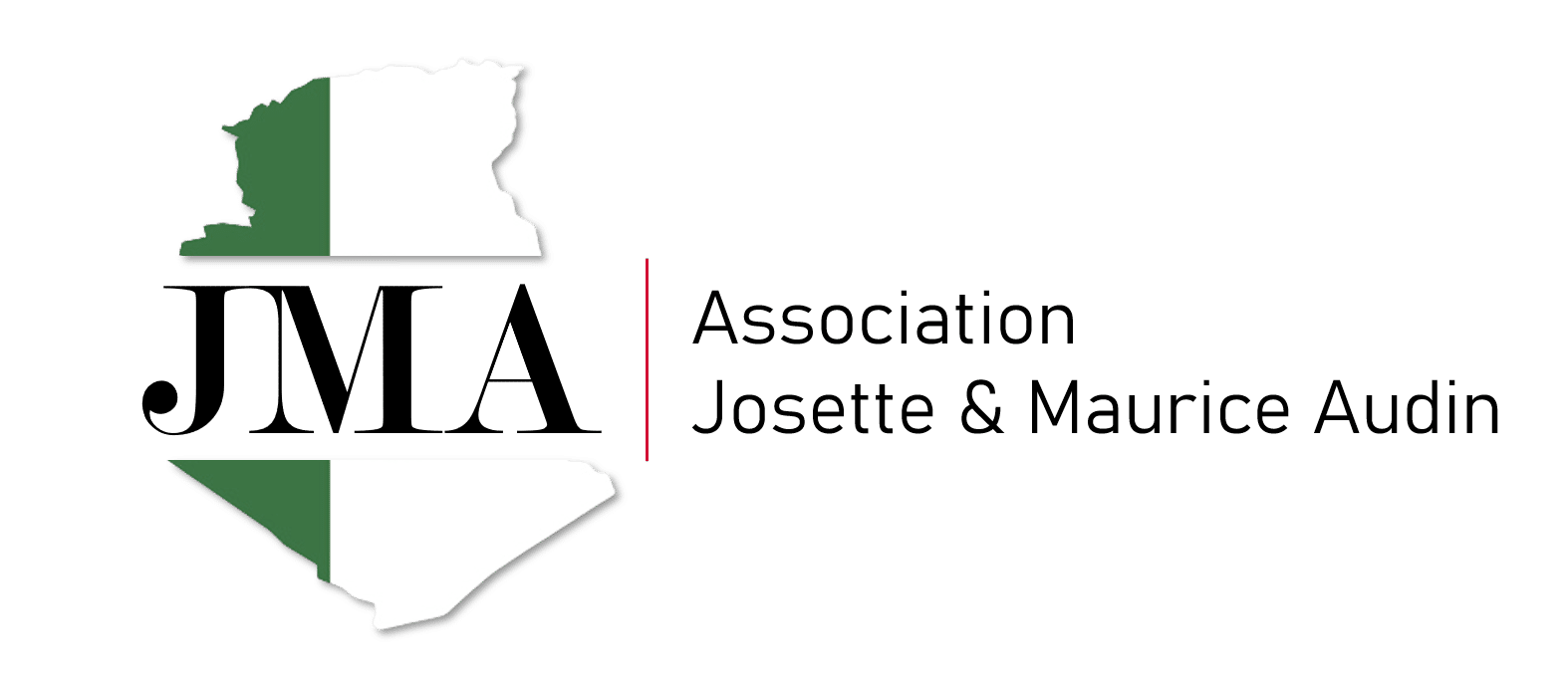Extrait de : Algérie : des « événements » à la guerre. Idées reçues sur la guerre d’indépendance algérienne, Paris, Le Cavalier Bleu, 2012 (Rééd. 2019).
« La bataille d’Alger est le symbole de la guerre d’Algérie. »
Voilà pourquoi, gonflés à bloc par leur succès algérois, [les parachutistes] vont attaquer le djebel avec une seule idée en tête : « étendre à toute l’Algérie les procédés utilisés », la bataille d’Alger constituant bel et bien un modèle, ou pour reprendre les termes du Commandement interarmées en mars 1957 une « action pilote », dans laquelle la torture est devenue l’arme principale.
Marie-Monique Robin, Les Escadrons de la mort, l’école française, 2004
La « bataille d’Alger » se déroula en 1957, en deux temps : de janvier à mars, puis de juin à octobre. Elle est cependant bien mal nommée, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un combat militaire mais d’une vaste opération de démantèlement des structures algéroises du FLN par les forces françaises sous la conduite du général Massu. Se plaçant d’un point de vue algérien, d’ailleurs, l’historien Gilbert Meynier propose de substituer l’expression « grande répression d’Alger » à celle de « bataille d’Alger ». Le film de Gillo Pontecorvo, tourné juste après l’indépendance et qui fit scandale en France, contribua à l’ériger en symbole de cette guerre. Qu’en est-il ?
La « bataille d’Alger » débuta le 7 janvier 1957, lorsque le général Massu, chef de la 10e DP (Division parachutiste) reçut les pouvoirs de police pour détruire la ZAA (Zone autonome d’Alger) du FLN. Mise en place en septembre 1956, celle-ci était dirigée par Larbi Ben M’Hidi, dont Yacef Saadi était l’adjoint. La ZAA devait organiser les Algériens de la ville, mobilisés au profit de la lutte pour l’indépendance. La ZAA était par ailleurs dotée d’un « réseau bombes ». Jusque-là, le FLN était surtout coutumier des attentats individuels par arme à feu. Le fait que des activistes pro-Algérie française aient eux-mêmes organisé un attentat à la bombe, rue de Thèbes, dans la Casbah, en août 1956, avait contribué à lever les scrupules de ceux qui, parmi les nationalistes, rechignaient au dépôt de bombes dans des lieux publics. À Alger, les premières avaient éclaté le 30 septembre 1956, dans deux cafés du centre-ville : le Milk Bar et la Cafétéria. Elles avaient fait quatre morts et plusieurs dizaines de blessés. Depuis, les explosions n’avaient plus cessé. En janvier, le FLN lança en outre un appel à la grève, dans l’objectif de faire une démonstration de sa représentativité, au moment où l’Assemblée générale de l’ONU devait étudier la « question algérienne ». Alors la 10e DP obtint les pouvoirs de police. Cette première phase prit fin avec l’arrestation de Larbi Ben M’Hidi. Après l’avoir victorieusement exhibé à la presse, menottes aux mains, les autorités françaises annoncèrent, le 5 mars 1957, qu’il s’était suicidé dans sa geôle – il avait en réalité été exécuté. Yacef Saadi, cependant, reprit le flambeau aidé d’Ali Amara, dit Ali la Pointe, un jeune proxénète dont la conscience politique avait pris naissance en prison. Les attentats, ouvrant la seconde phase, reprirent en juin. Puis l’arrestation de Yacef Saadi, le 24 septembre, ainsi que la mort d’Ali la Pointe, dont la cache fut dynamitée par les parachutistes, le 8 octobre, mirent définitivement fin à la ZAA.
Les méthodes déployées à Alger allièrent un travail de police guidé par la seule recherche de l’efficacité et un quadrillage serré de la population, inspiré des préceptes de la guerre contre-révolutionnaire. Ces préceptes, tirés de l’analyse de la guerre d’Indochine, se fondaient sur l’adage bien connu de Mao, selon lequel le révolutionnaire se meut dans la population comme un poisson dans l’eau ; il suffirait par conséquent d’assécher le bocal pour que le poisson meure. Pendant la « bataille d’Alger », les parachutistes encerclèrent la Casbah, où se concentraient les Algériens de la ville et où la ZAA avait ses caches. Ils en filtraient les entrées et les sorties à des points de passage obligatoires. Les habitants de la Casbah furent aussi soumis à des rafles accompagnées de perquisitions ; des centaines et des centaines d’hommes étaient alors emmenés et leur identité vérifiée. Ainsi étaient-ils fichés et des « suspects » désignés, par recoupement avec les informations dont disposaient les forces de l’ordre par ailleurs – l’armée avait récupéré les fichiers de la police.
À la tête de milliers d’hommes, le général Massu s’était adjoint les services du colonel Trinquier et du commandant Aussaresses. Par son Dispositif de protection urbaine (DPU), un dispositif de contrôle et de répression, le colonel Trinquier devait maîtriser l’espace, les maisons elles-mêmes devant être numérotées et leurs habitants recensés ; elles étaient regroupées en îlots, chacun ayant un responsable, désigné. Quant au commandant Aussaresses, il chapeautait les opérations concrètes de démantèlement de la ZAA : croisement des renseignements, reconstitution de son organigramme, traque de ses membres, voire leur exécution – celle de Larbi Ben M’Hidi, notamment. Dans ce contexte, l’usage de la torture fut généralisé, tandis que le contrôle des arrestations et des détentions devenait aléatoire. Les militaires faisaient en effet du secret de leurs opérations une des conditions majeures de leur réussite. Non seulement les réseaux ne devaient pas être alertés par l’arrestation d’un de leurs membres, mais certains d’entre eux, retournés au profit des Français, furent relâchés et jouèrent un double jeu dévastateur. Le capitaine Léger imagina en outre d’infiltrer des hommes, habillés en tenue de travailleurs – des « bleus de chauffe » – au sein de la population, afin de mieux l’espionner.
Sans conteste, le FLN sortit vaincu de cette « grande répression ». Jusque-là, l’organe dirigeant du FLN, appelé Comité de coordination et d’exécution (CCE), était installé à Alger. Après l’arrestation de Larbi Ben M’Hidi, qui en faisait partie, ses quatre membres restants – Abbane Ramdane, Krim Belkacem, Benyoucef Ben Khedda et Saad Dahlab – partirent se mettre à l’abri au Maroc et en Tunisie. Par la suite, la direction de la lutte pour l’indépendance se fit toujours de l’étranger. La coupure entre ceux de l’extérieur, tête politique dirigeante de la lutte algérienne, occupée en particulier à son internationalisation, et ceux de l’intérieur, combattant concrètement, en butte à la répression, constitua une fracture durable. À Alger même, jamais le FLN ne fut en mesure de relancer l’offensive. La ville fut toutefois par la suite le siège de manifestations de masse valant démonstration de sa représentativité : en décembre 1960, pour l’indépendance, à l’occasion d’un voyage du général de Gaulle ; en juillet 1961, contre la partition du pays que les Français envisageaient, afin de conserver le Sahara.
Dans la population algéroise, cette grande répression resta synonyme de terreur. Les débarquements inopinés de troupes dans les rues et les maisons redoublaient la pression quotidienne des patrouilles et des contrôles. À la crainte des arrestations et des mauvais traitements s’ajoutait celle de la disparition ultime, synonyme d’une mort sous la torture ou d’une exécution sommaire, suivie de la dissimulation du cadavre. Le supplice touchait les vivants, restés à jamais sans nouvelle de leur proche. Selon Raphaëlle Branche, dans La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie (2001), les disparitions en masse qui résultèrent des opérations de la « bataille d’Alger » ne constituèrent pas des « ratés du système » mais bien un « élément du dispositif ». Marcel Bigeard, chef du 3e RPC (régiment de parachutistes coloniaux) qui avait en charge de larges secteurs de la ville, donna par ailleurs son nom à une pratique témoignant aussi d’une logique de démonstration de la violence, prenant tous les Algériens pour cible : les fameuses « crevettes Bigeard », ces cadavres d’hommes jetés à l’eau, que ramenait la marée.
Ce système de répression militaire alliant quadrillage, travail de police et terreur comprenait aussi un pan légal. L’exercice des pouvoirs de police par le général Massu découlait de l’application d’un décret du gouvernement de Guy Mollet, signé grâce aux pouvoirs spéciaux qu’il avait obtenus de l’Assemblée nationale. Ce texte autorisait la délégation des pouvoirs de police aux militaires. Progressivement mise en œuvre, celle-ci aboutit à ce que, à l’été 1957, l’armée en disposait sur tout le territoire de l’Algérie. Ces pouvoirs officiels impliquaient l’existence de centres de détention à destination des « suspects » ainsi arrêtés : ce furent les « centres de tri et de transit », où se déroulaient les interrogatoires. Ils coexistaient avec des centres de détention officieux. Ainsi nombre de villas d’Alger devinrent-elles célèbres comme lieux de torture. Dans le Sud algérois, l’armée aménagea aussi en 1957 le camp de Paul-Cazelles (Aïn Oussera), où furent durablement détenus des « suspects » arrêtés et qui fut a posteriori officialisé comme camp d’internement. Enfin, des milliers d’inculpés furent déférés au tribunal militaire d’Alger, lequel prononça force peines capitales. Avec cette face visible de la répression, les métropolitains mirent un nom sur quelques-uns des visages du « réseau bombes » de la ZAA ; ceux des femmes, en particulier, utilisées pour franchir les barrages alors qu’elles transportaient les engins explosifs. Jacques Vergès plaida ainsi pour la première fois en Algérie au printemps 1957, pour la défense de Djamila Bouhired, condamnée à mort, en faveur de laquelle il anima une campagne de grâce. Yacef Saadi fut de même condamné et gracié. À Paris, pourtant, les rejets de recours en grâce pleuvaient. En fait, les exécutions et les attentats se répondaient, entretenant un cycle infernal de violence réciproque. À ce titre, deux rencontres eurent lieu, dans la seconde phase de la « bataille d’Alger », entre Yacef Saadi et Germaine Tillion. Ils tombèrent d’accord pour une trêve des attentats en l’échange de l’arrêt des exécutions, que Germaine Tillion tenta d’obtenir du gouvernement français. Ce fut peine perdue. En 1957, près d’une centaine de condamnés à mort furent exécutés.
Si la « bataille d’Alger » est connue dans ses aspects militaires, il ne faut pas oublier, par conséquent, qu’elle se déroula sous l’égide des autorités civiles. Le ministre résidant en Algérie, Robert Lacoste, ainsi que les gouvernements parisiens, connaissaient et soutenaient l’action des militaires dans la ville. Ils répondirent aux protestations métropolitaines en concédant la formation d’une commission de sauvegarde des droits et libertés individuels, chargée d’enquêter en Algérie. Celle-ci rendit un rapport très bien informé mais qui resta sans suite ; au point que la plupart de ses membres démissionnèrent pour protester. En France, en effet, la « bataille d’Alger » signa le début de la dénonciation massive de la torture, des exécutions sommaires, des violences de l’armée française mais aussi de ses mensonges. La mobilisation débuta après l’annonce du « suicide » de Larbi Ben M’Hidi ; elle ne cessa plus. Du point de vue de l’opinion métropolitaine, la « bataille d’Alger » marqua un point de non-retour : moment fort de dénonciation de la guerre, elle enclencha un mouvement entretenu jusqu’à la fin. Il était impossible, désormais, de nier que les Français torturaient en Algérie.
Perçue comme une entreprise de démoralisation de l’armée, cette mobilisation n’entama en rien la perpétuation des méthodes qui avaient fait leur preuve à Alger. Si elles ne pouvaient être strictement reproduites qu’en milieu urbain, elles reposaient sur des principes qui, de fait, furent généralisés. Suivant les principes de la guerre contre-révolutionnaire, d’une part, le contrôle de la population était l’enjeu de la guerre. Les Algériens devaient donc à la fois être très étroitement placés sous contrôle et dissuadés – y compris par la terreur – de s’engager dans la lutte pour l’indépendance. La priorité de recherche du renseignement, d’autre part, plaça le démantèlement des structures du FLN au premier rang des missions à accomplir, par toutes les méthodes possibles. Ce n’est pas un hasard, remarque Raphaëlle Branche, si le développement des DOP (Détachements opérationnels de protection) prit un élan décisif en 1957. La mission de ces organismes spéciaux était précisément la destruction de « l’organisation politico-administrative » du FLN : réseaux de collecte de fonds et de propagande, en particulier. Les DOP étaient dotés de leurs propres locaux et de leurs propres personnels : des militaires mais aussi des policiers et des gendarmes. Ils érigèrent le secret en principe de leur action. Par ailleurs, les méthodes de la bataille d’Alger furent enseignées dans une école militaire ouverte dès 1958, près de Philippeville (Skikda). Créée sur décision du ministère des Armées, son organisation fut confiée à Marcel Bigeard, au titre de ses succès contre la ZAA.
Moment de formalisation d’un système, dans le contexte de la lutte contre la ZAA du FLN et de l’octroi des pouvoirs de police au général Massu, la « bataille d’Alger » puise cependant dans une expérience antérieure décisive : la guerre d’Indochine. Si le général Massu n’y était pas, le colonel Trinquier, le commandant Aussaresses et le colonel Bigeard, eux, en revenaient. Ayant tiré les leçons de leur défaite, ils trouvèrent dans les circonstances de cette année 1957, en terrain algérois, l’occasion de mettre en œuvre les méthodes qui, d’après eux, leur avaient fait défaut contre le Viet Minh. La « bataille d’Alger » fit ainsi de la guerre d’indépendance algérienne un maillon central dans la transmission d’une nouvelle forme de guerre, appelée à faire école ensuite bien au-delà de l’Algérie ; en Amérique latine, en premier lieu, où l’expérience servit aux forces des dictatures militaires des années 1970.
La « bataille d’Alger » masque l’histoire de la guerre dans le bled, celle qui fut menée contre les maquis. Des hommes du contingent participèrent bien à la « bataille d’Alger », dans les unités où ils étaient affectés, celles des parachutistes, notamment, qui n’étaient pas composées que d’engagés. La guerre dans le bled laissa aussi au contingent le souvenir de longues heures d’attente dans l’isolement d’un poste marquant le territoire de la présence française. Une attente rompue, de nuit souvent, par des embuscades prenant les maquis pour cible, avec son cortège de suites : morts et blessés, prisonniers, interrogatoires. Ce vécu-là imprègne les mémoires mais aussi les représentations de cette guerre, à travers l’autre film qui en est le symbole : Avoir vingt ans dans les Aurès, de René Vautier. Il est logique, cependant, que la « bataille d’Alger » l’emporte, et pas seulement à cause du succès du film de Gillo Pontecorvo, dans lequel Yacef Saadi joue son propre rôle. Le réinvestissement des principes qui guidèrent l’action de l’armée pendant cette « bataille », que ce soit en Algérie pendant la guerre d’indépendance elle-même ou par la suite, lui donne bien une portée particulière.