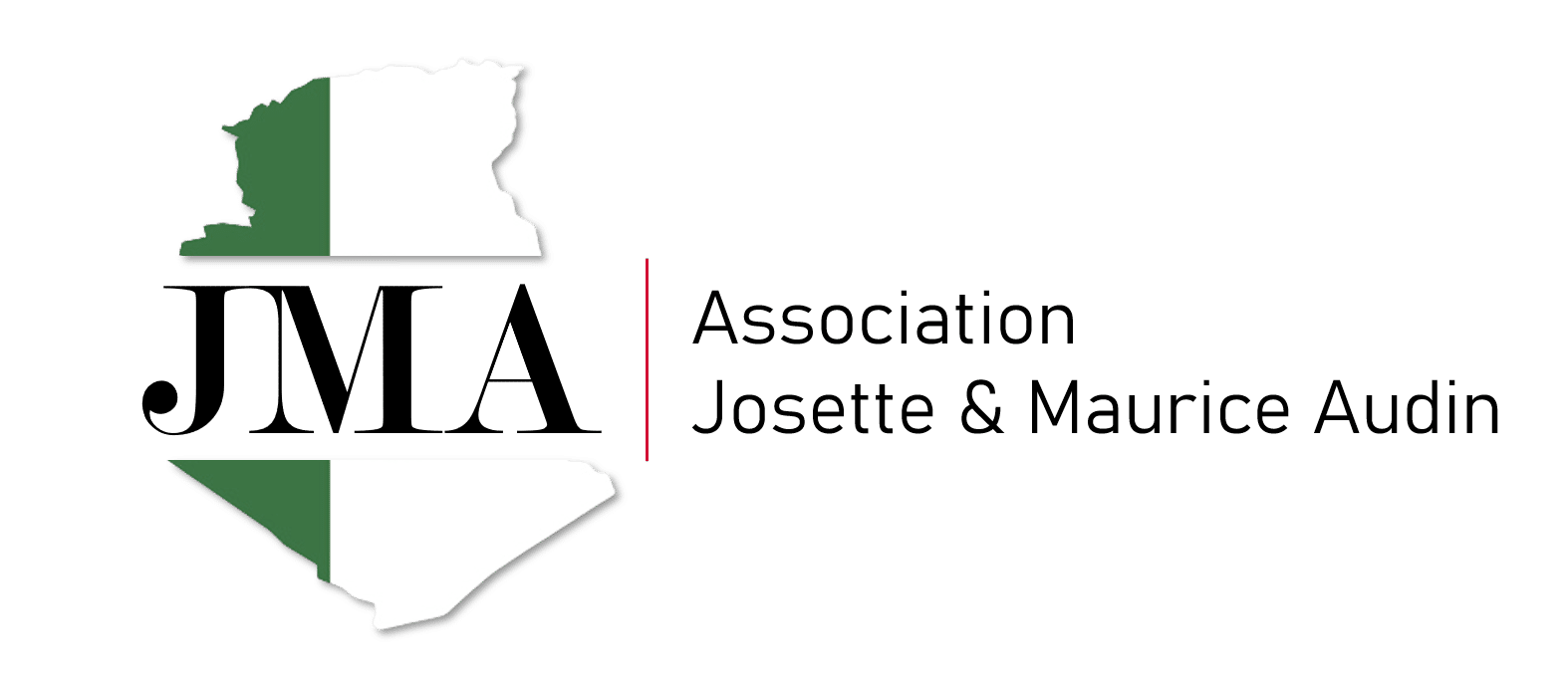Sylvie Thénault, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
13 septembre 2018
Depuis 61 ans, lorsque son mari a été arrêté par les parachutistes dans Alger alors en pleine guerre, Josette Audin s’est battue.
Pour la vérité, d’abord, puis pour une reconnaissance des responsabilités militaires et politiques. À défaut de pouvoir reconstituer les circonstances de la mort de Maurice Audin, d’en identifier les coupables, de les traduire en justice et de les condamner dans la solennité de l’arène judiciaire, l’appel à la reconnaissance cherchait, d’une certaine façon, la sanction d’une parole officielle. Les mots de la reconnaissance, prononcés en haut lieu, viendraient alors réparer ce déni de justice que des décennies de vaines procédures ont constitué en forteresse imprenable.
L’amnistie de 1962, en effet, a stoppé l’instruction de la plainte déposée par Josette Audin pour enlèvement et séquestration. Josette Audin a ensuite tenté d’obtenir le bénéfice des lois d’indemnisation existant en droit français jusqu’à ce que le Conseil d’État la déboute, en 1978. Il a fallu une mesure de Robert Badinter, l’un de ses avocats devenu ministre de la Justice, pour qu’une indemnisation financière lui soit accordée, ainsi qu’à ses enfants. Mais quelle réparation ? Une mesure gracieuse, matérielle, décidée dans le huis clos d’un cabinet ministériel. Comme une mesure nécessaire mais honteuse, à l’insu des regards et sans adoubement officiel.
Alors la reconnaissance, c’est d’abord cela : la réparation pour la victime de l’armée française qu’a été Josette Audin ainsi que, avec elle, ses enfants. L’État reconnaît ses torts et légitime ce combat qui est celui d’une vie. La reconnaissance a cette dimension sensible, psychologique, affective pratiquement. Pour les historiens et les historiennes qui ne manquent pas d’avoir à cœur le sort des victimes quand ils analysent les répressions de masse, cette dimension n’est pas négligeable et elle doit être dite, en premier. Les mots de la reconnaissance sont faits pour panser ce qui peut l’être des plaies ouvertes par le passé.
Un système de répression
Reconnaître que l’armée et les autorités politiques françaises sont responsables de la mort de Maurice Audin, cependant, va bien au-delà. Obligatoirement. Car l’enquête sur la disparition de Maurice Audin conduit à la découverte d’un système de répression fondé sur l’exercice des pouvoirs de police par l’armée, conduisant à des arrestations en masse, sur simple suspicion, des détentions dans des lieux parfois officiels, parfois officieux, au secret, en dehors de tout contrôle, des interrogatoires avec toutes les violences possibles que dictent, tout à la fois, la lutte sans merci contre l’ennemi, la recherche du renseignement, la terreur assumée comme l’un des moyens d’anéantir tout soutien à la lutte pour l’indépendance.
Puisque la disparition de Maurice Audin résulte d’un système, elle n’est pas un accident, elle n’est pas une bavure, elle n’est pas un excès. Et Maurice Audin est une victime du système parmi toutes les autres que le système a faites. À travers la reconnaissance des responsabilités de l’État dans la disparition de Maurice Audin, par conséquent, les responsabilités de l’État dans toutes les disparitions de cette année 1957 à Alger ne sont-elles pas reconnues ?
Jusqu’où va la reconnaissance alors ? Sur un plan symbolique, la reconnaissance n’est-elle pas extensible ? Ne vaut-elle pas reconnaissance des responsabilités de l’État dans la pratique de la torture ? Du point de vue historique, l’analyse de la « Bataille d’Alger » n’épuise pas la compréhension de la pratique de la torture pendant cette guerre, qui a eu d’autres contextes, d’autres logiques sur l’ensemble du conflit. La généralisation est ici délicate au-delà d’un plan symbolique mais le symbolique reste important.
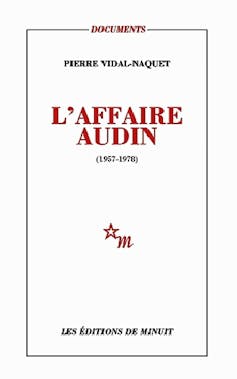
Il l’est d’autant plus qu’aucune reconnaissance n’a été faite jusqu’ici. Les historiens et les historiennes apparaissent bien comme des pionniers : ils ont depuis longtemps, avec Pierre Vidal-Naquet dès la guerre elle-même, décortiqué les ressorts du développement de la torture et de sa légitimation dans les rangs militaires comme dans l’arène politique. Aussi une reconnaissance élargie permettrait à la vérité de se frayer un chemin jusqu’au sommet du pouvoir. Elle met un terme aux dénégations politiques sans fondement, niant l’évidence de ce qu’a été cette guerre-là, les moyens avec lesquels elle a été menée, les mécanismes par lesquels elle a fait advenir des violences de masse.

Les conflits d’Algérie et de la Seconde Guerre mondiale
Enfin, la reconnaissance restaure l’équilibre avec la Seconde Guerre mondiale. La comparaison entre les deux guerres a largement été menée dans l’historiographie de la mémoire. Elle conduit d’évidence à souligner les analogies entre ces deux séquences conflictuelles de l’histoire de la France contemporaine : toutes deux sont des « zones d’ombre », des « périodes taboues », des « passés qui ne passent pas », suscitent la honte, le traumatisme, auraient été refoulées avant de resurgir et faire polémique, loin de toute sérénité. Toutes deux ont déchiré la société – et par conséquent, la nation – française. Au titre de leurs analogies et des leçons à en tirer, toutes deux peuvent d’ailleurs être traitées au choix dans les programmes de terminale au lycée.
Bien des différences pourtant les séparent. Après la guerre d’indépendance de l’Algérie, en particulier, pas de procès pour les crimes qui ont pu être commis. L’amnistie a effacé les peines déjà prononcées – qui, dans le cas de la torture, se comptent sur les doigts d’une main –, bloqué les procédures ouvertes et empêché toute nouvelle plainte. À partir des années 1980/1990, avec les procès Barbie, Touvier et Papon, cette distorsion entre le traitement judiciaire de l’une et l’autre des périodes est devenue éclatant.
Du point de vue de la reconnaissance, aussi, le déséquilibre est flagrant. Le discours de Jacques Chirac qui, en 1995, a reconnu les responsabilités françaises dans la déportation des juifs de France, à l’occasion de la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv, a fini par devenir un modèle à suivre : à quand une reconnaissance équivalente des responsabilités françaises dans les violences extrêmes dont se sont rendues coupables les forces de l’ordre dans l’Algérie en guerre ? Si le 13 septembre n’a rien d’une date marquante dans la chronologie de la guerre d’indépendance algérienne, il pourrait le devenir dans l’histoire de sa mémoire.
Sylvie Thénault, Historienne, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.