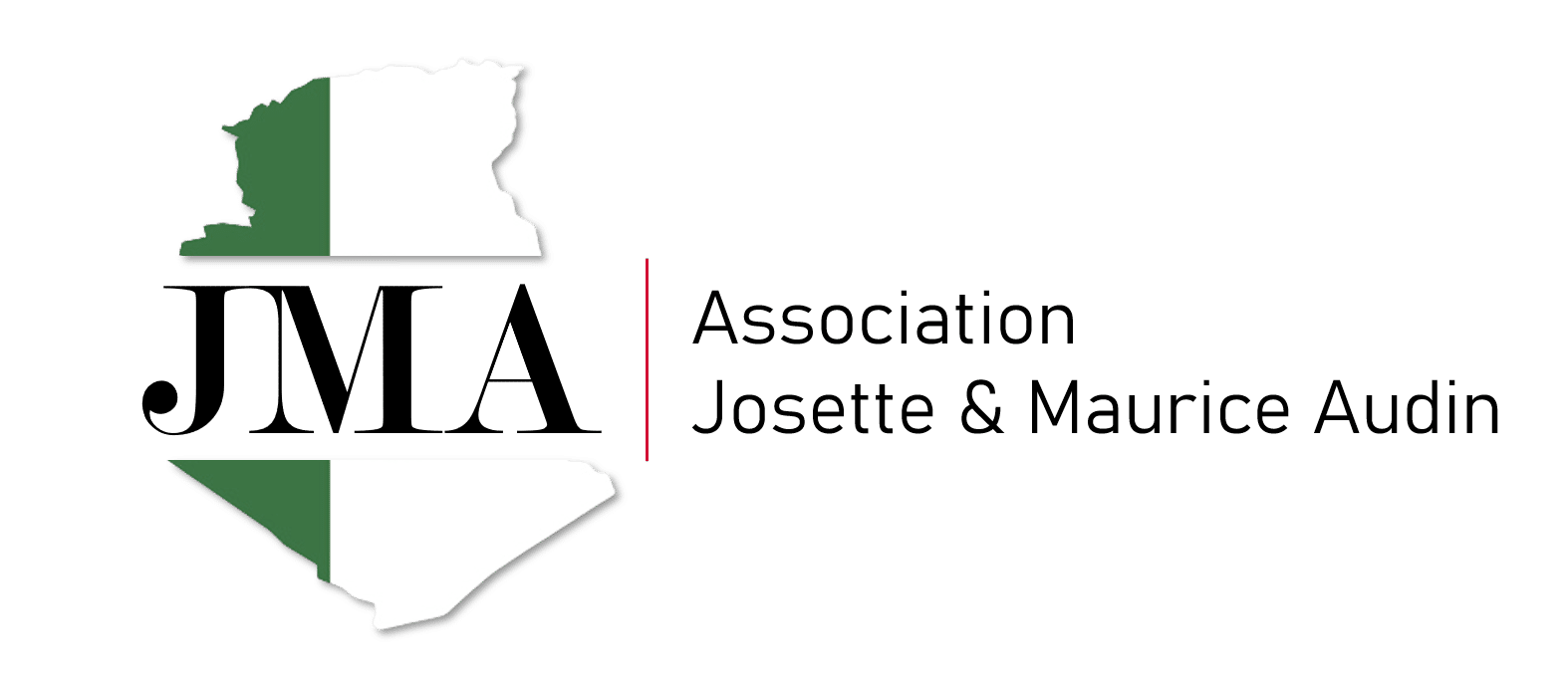Textes publiés par le Comité Maurice Audin (première édition : Minuit, 1962)
Préface à l’édition de 2002
Par Pierre Vidal-Naquet
Pour Maud Sissung
Pourquoi rééditer aujourd’hui, en 2002, ce livre construit durant les derniers jours de 1961, achevé dans les premières semaines de 1962 et publié au mois d’avril, alors que la paix était signée depuis le 18 mars, l’amnistie proclamée – je la commente en fin de volume – et que l’armée française ne combattait plus le FLN, désormais « considéré comme un parti politique légal » avant de disposer du monopole du pouvoir ? Mais elle était encore combattue par l’OAS (Organisation armée secrète), coalition hétéroclite formée par des militaires qui souhaitaient continuer la lutte pour l’Algérie française, par des « colons » qui, non sans logique, voyaient mal la place qui pouvait être la leur dans une Algérie indépendante, nationaliste et communautaire, et par de redoutables antennes en métropole dans les milieux d’extrême droite. De Gaulle régnait, mélangeant art de la persuasion et maniement de l’autorité. S’agissait-il, en 1962, de prouver l’existence de la torture ? On n’en était plus là. La Question d’Henri Alleg avait été publiée en 1958 aux Éditions de Minuit et avait reçu un accueil qui dépassait, et de très loin, le petit monde des militants anticolonialistes, communistes ou sympathisants de la Nouvelle Gauche.
S’agissait-il de montrer que certains n’hésitaient pas à la justifier ? On pouvait lire cette justification partout, dans les romans de gare et dans les traités des colonels, dans les hebdomadaires de l’extrême droite et dans le silence navré des quotidiens centristes. Cette même extrême droite, Carrefour, La Nation française, avait cependant découvert que ses militants pouvaient, eux aussi, être torturés. Ils s’en indignaient fort et, à leur grande surprise, nous étions quelques-uns à nous en indigner aussi. Qui avait donné l’ordre de torturer ? Nous savions que trois ministres du gouvernement Guy Mollet, Maurice Bourgès-Maunoury, Robert Lacoste, Max Lejeune, avaient autorisé la torture, mais c’est seulement le 1er août 1962 que le capitaine Joseph Estoup, témoignant au procès du lieutenant OAS Daniel Godot, révéla que le général Massu avait transmis, en janvier 1957, l’ordre de torturer .
Quelle avait été, depuis la fin des années cinquante, notre quête ? Je dis notre parce que, pendant ces temps terribles, je militais au sein du Comité Maurice Audin, fondé en novembre 1957 pour faire la lumière sur la disparition d’un jeune mathématicien de ce nom, arrêté à Alger par les parachutistes le 11 juin 1957 et disparu le 21 du même mois. Dans ce « groupuscule », comme on l’aurait désigné en mai 1968, je me voulais historien, historien de la tête aux pieds, aux côtés de Luc Montagnier, Michel Crouzet, Jacques Panijel, Madeleine Rebérioux, Élisabeth Labrousse, Pierre Deyon et beaucoup d’autres, à Paris et dans une ample province. Nos présidents se sont appelés successivement Albert Châtelet et Laurent Schwartz et nos vice-présidents, Jean Dresch et Henri Marrou.
Nous entendions, par-delà l’élucidation de la disparition d’Audin, mettre le pays au clair sur l’engagement et la responsabilité de l’État français dans la pratique de la torture et de l’assassinat dans la guerre d’Algérie, responsabilité au sommet, en partant du para de base et en remontant jusqu’au président de la République. Responsabilité au niveau du langage, caractérisé tout au long de la période par l’usage massif de la dénégation, responsabilité au niveau de la pratique, depuis l’ordre donné tacitement jusqu’à la prise de courant branchée dans les chambres de la villa Sésini à Alger et dans les commissariats ou les gendarmeries à Paris ou à Avesnes-sur-Helpe (Nord) . Pour cela, il me fallait des documents, procurés par des témoins indirects ou immédiats. Ces types de documents étant par définition secrets, ils ne pouvaient être fournis que par des « traîtres ». Les circonstances avaient joué en notre faveur.
La IVe République avait succombé lors de la crise de mai 1958, emportant avec elle de hauts fonctionnaires qui avaient tenté de faire obstacle à l’implacable déroulement de la perversion des valeurs de la République. Cela pour le sommet, et qui devait me fournir d’incroyables documents voués en principe au silence des archives, tel le rapport de l’inspecteur général de l’administration Roger Wuillaume, chargé par François Mitterrand, ministre de l’Intérieur du gouvernement Mendès France, d’enquêter sur les « rumeurs » de sévices et qui, dès le début de mars 1955, concluait non seulement à la réalité courante de la torture, mais aussi à la nécessité de la légaliser. Nommons ceux qui furent, par excellence, les « traîtres » qui m’ouvrirent leurs archives. Ils étaient trois. Robert Delavignette était un ancien gouverneur de ce qu’on appelait avant 1945 l’Empire – il avait été notamment gouverneur général du Cameroun et directeur de l’École nationale de la France d’Outre-mer, qu’on appelait jadis tout simplement l’École coloniale. C’est là dire qu’il n’était pas un anticolonialiste de principe, mais il avait au plus haut degré le sens de l’État. Comme membre de la « Commission de sauvegarde des droits et libertés individuels » instituée le 5 avril 1957 par le gouvernement Guy Mollet, il avait vu l’État littéralement se décomposer en Algérie, livrant le pays à l’arbitraire d’un lieutenant sinon même d’un simple sous-officier investi du droit de torturer, voire d’assassiner. Robert Delavignette n’était pas un historien de métier, mais il avait collaboré avec le plus célèbre des historiens de la colonisation, Charles-André Julien, qui enseignait cette discipline à la Sorbonne.
Ce dernier non plus, même s’il avait beaucoup évolué sous la poussée des événements, n’était pas un anticolonialiste de principe. L’épouse de Robert Delavignette avait été la femme d’Alphonse Mairey, militant socialiste, proche de Jean Jaurès, tué à l’ennemi pendant la Première Guerre mondiale. Son fils, Jean Mairey, était lui aussi socialiste, mais pas de l’espèce Guy Mollet. Agrégé d’histoire, résistant, il avait été commissaire de la République, en 1944, à Dijon. Il avait eu à cette époque l’occasion de lutter contre la torture, celle qu’infligeaient parfois des résistants à des collaborateurs réels ou supposés. Il avait formellement interdit cette pratique. Nommé directeur de la Sûreté nationale par Pierre Mendès France, il finit par être révoqué par Guy Mollet. On trouvera dans ce volume deux des trois rapports qu’il remit au gouvernement en 1955 et au tout début de 1957. Ils attestent sans contestation possible que les pouvoirs publics savaient tout et étaient demeurés silencieux et menteurs. C’était Mairey qui m’avait remis le rapport de son beau-père à la Commission de sauvegarde, établissant que des dizaines d’Algériens avaient été enfermés dans des chais où ils avaient été intoxiqués jusqu’à ce que mort s’ensuive.
C’était Delavignette qui m’avait communiqué les rapports de Jean Mairey et le terrifiant rapport Wuillaume. C’était lui aussi qui m’avait remis un exemplaire du rapport de Maurice Garçon, célèbre avocat et secrétaire général de la Commission de sauvegarde. Troisième grand témoin enfin, Paul Teitgen (1919-1991), ancien secrétaire général de la préfecture d’Alger, chargé de la police générale d’août 1956 à septembre 1957. Je le nomme en dernier, mais c’est lui que je connus de plus près. Je devins et demeurai son ami jusqu’à sa mort. Dans l’affaire Audin, il était le témoin capital, celui qui sut, dès 1957, qu’Audin avait été assassiné et qu’il ne s’était pas évadé. Il avait lu mon livre de mai 1958 et avait donné sa caution à mon analyse historique. C’était lui qui, dès la fin de 1956, avait recueilli les confidences du général Jacques Faure, en poste en Algérie, et permis ainsi de démasquer le premier complot militaire contre la République. Paul Teitgen appartenait à une grande famille lorraine de formation démocrate-chrétienne au temps où ce mot signifiait quelque chose. Comme tous les Teitgen, du moins ceux que j’ai entendus, son père Henri, ses frères Pierre-Henri et François, c’était une « grande gueule ». Sa voix rauque pouvait atteindre les sommets de l’éloquence. Résistant, il avait été torturé et déporté. D’autres avaient subi le même sort et n’en avaient tiré aucune leçon.
Quand il découvrit que les supplices infligés aux Algériens rappelaient de fort près ceux que pratiquaient la Gestapo et ses complices français, il s’indigna et démissionna, demeurant cependant à Alger pour occuper une direction au gouvernement général. En 1958, arrêté à l’occasion du putsch du 13 mai, il fut échangé contre un général factieux détenu à Paris et put ainsi regagner la métropole. Le nouveau régime l’envoya le plus loin possible, au Brésil. Il m’ouvrit ses archives et me remit non seulement sa propre « note » à la Commission de sauvegarde en date du 1er septembre 1957, mais trois autres documents qui le précèdent dans ce livre, notamment l’extraordinaire justification de la torture rédigée conjointement par le colonel Roger Trinquier et le R.P. Louis Delarue, aumônier des parachutistes : « Entre deux maux choisir le moindre. » C’est lui qui m’a permis de faire un tout de la première partie de ce livre . On le remarquera par un simple coup d’œil à la table des matières, les documents postérieurs au 13 mai 1958 ne sont pas tout à fait de même nature que ceux qui datent de la IVe République. Disons-le d’un mot : l’État, restauré par le général de Gaulle et Michel Debré, garda mieux ses secrets. De la Commission de sauvegarde ranimée pendant l’été 1958, chapeautée par Maurice Patin en sa qualité de président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, un seul document filtra à l’extérieur, au profit de l’hebdomadaire maurrassien La Nation française. Il s’agit du rapport de Pierre Voizard, ancien résident général en Tunisie, qui enquêta sur les sévices – bien réels – infligés aux membres de l’OAS.
On le trouvera ici à sa place chronologique. Encore aujourd’hui, les archives de cette seconde Commission de sauvegarde ne sont pas communiquées aux chercheurs qui demandent à les consulter . Pour autant, les documents ne me manquèrent pas. Ils provinrent essentiellement de deux sources. À la fin de 1961, le journaliste Gilles Martinet, alors directeur de France-Observateur, me remit quelques rouleaux de pellicule photographique non développés. Il s’agissait, me dit-il, de documents sur la répression. Je les fis discrètement tirer, et ce que je pus lire était effectivement exceptionnel. On y trouvait notamment une circulaire du colonel Renoult, commandant le secteur de Batna dans les Aurès, invitant ses subordonnés à liquider sur place les membres de l’organisation civile du FLN qui viendraient à être capturés. Nous sommes le 14 août 1959, un mois et deux jours avant le discours du 16 septembre 1959 sur le droit à l’autodétermination des Algériens. Mais, dans cet ensemble, le texte le plus étonnant, issu des mêmes archives, était le rapport rédigé en juin 1961 par le lieutenant Chesnais, chef d’une harka. L’interruption des opérations offensives décidée unilatéralement par le pouvoir français au moment où s’engageaient les négociations d’Évian (20 mai 1961) avait semé la panique dans la harka que commandait cet officier. Les harkis se demandaient s’ils avaient fait le bon choix. Ce n’est là qu’un exemple parmi d’autres de la tragédie que vécurent ces supplétifs. Le lieutenant Chesnais avait rétabli la confiance en autorisant ses harkis à tuer six combattants prisonniers.
D’où venaient ces documents ? Je ne le sus que plusieurs mois après la fin de la guerre. Un jeune soldat, Jacques Inrep, les avait photographiés clandestinement dans les archives du secteur de Batna, courant ainsi les plus grands risques. Il est, fort heureusement, bien vivant, et exerce le métier de psychanalyste dans une petite ville proche de Montpellier. Qu’il soit aujourd’hui solennellement remercié de son courage et de son aide. Une autre source me permit, plus indirectement, d’enrichir ma documentation. Au ministère de la Justice, occupé par Edmond Michelet de janvier 1959 à août 1961, fonctionna pendant un peu plus d’un an une équipe formée par deux anciens camarades de déportation (à Dachau) du ministre, Gaston Gosselin et Joseph Rovan. Tous deux étaient résolument hostiles aux pratiques en honneur en Algérie. Si Rovan agit de façon discrète, Gosselin n’hésita pas à provoquer des scandales, par exemple en communiquant au journaliste Pierre Viansson-Ponté le rapport sur l’Algérie du Comité international de la Croix-Rouge : ce document capital fut publié dans Le Monde du 5 janvier 1960. C’est aussi par cette voie que fut connu le rapport établi en décembre 1958 par un jeune inspecteur des finances, Michel Rocard, montrant à quels résultats désastreux avait abouti la politique de regroupement des populations instituée, très tôt, par l’armée, et conduisant à la famine. Le Monde du 18 avril 1959 publia les « bonnes feuilles » de ce rapport sinistre. C’est ce journal qui en communiqua la version intégrale à Témoignages et Documents, dont j’étais alors le rédacteur en chef au côté de Maurice Pagat, et qui le publia intégralement.
De tous les documents reproduits dans ce livre, c’est sans doute le plus significatif sur le plan historique. Son auteur manifesta un peu d’inquiétude au moment de la publication de ce réquisitoire glacé et glaçant. Il peut aujourd’hui en être légitimement fier. C’est encore par Le Monde que me parvint un texte étonnant, le jugement du tribunal d’Avesnes-sur-Helpe condamnant en octobre 1961 à des peines insignifiantes des gendarmes qui avaient utilisé l’électricité pour interroger des Algériens suspects. Encore ont-ils été condamnés, ce qui n’était pas fréquent. L’enquête menée à Rennes sur l’affaire Audin par le juge d’instruction Étienne Hardy, qui s’illustra après la « loi » d’amnistie du 22 mars 1962 – en fait un simple décret pris en vertu des pleins pouvoirs – en rendant une ordonnance de non-lieu pour « insuffisance de preuves », fournit également quelques documents de première main. C’est le cas des témoignages du procureur général Jean Reliquet et du général Marie-Paul Allard sur la permission de torturer qui avait été donnée, de Paris, au temps du gouvernement Guy Mollet.
Ce que le général Allard n’expliqua pas à Rennes, c’est l’acharnement avec lequel lui-même mit à profit cette bienveillante permission, fait établi par les travaux de Raphaëlle Branche et de Sylvie Thénault . Nous avions accès à ce dossier par les avocats de Josette Audin, Jules Borker, Pierre Braun et le bâtonnier René William Thorp. Un autre rapport, confidentiel en principe, celui qu’avait établi un officier de la DST sur l’organisation algérienne au camp de Paul-Cazelles (24 août 1959), m’avait été remis par Me Jacques Vergès. On ne saurait dire, sans lui porter ombrage, que ce dernier avait la passion de la vérité. Telle n’est pas d’ailleurs, dans une société démocratique, la fonction d’un avocat. Personnage plutôt diabolique, Jacques Vergès aurait bien voulu supprimer dans ce document toute référence à l’existence du MNA . Sur mon refus catégorique, il n’insista pas. Je dois à la vérité de le dire aujourd’hui. C’est un groupe de jeunes appelés qui me fit parvenir le rapport sur la ferme Améziane qu’ils avaient établi à partir de la documentation disponible sur place. Il s’agissait d’un gigantesque centre de torture. Son étude a été faite depuis par Jean-Luc Einaudi . Il n’est peut-être pas inutile d’ajouter que le chef de ce centre, le capitaine Rodier (promu ensuite commandant puis lieutenant-colonel), est aujourd’hui maire nommé d’un des villages fantômes voisins de Verdun, en l’espèce Fleury-sous-Douaumont. Par un remarquable accident chronologique, le dernier document secret publié dans La Raison d’État est une circulaire du général Le Puloch condamnant, le 1er février 1962, les sévices infligés à de jeunes recrues du contingent. Cette condamnation aura des suites sur lesquelles je me suis expliqué ailleurs. Ce fut l’« opération catharsis ». Avec l’accord du gouvernement, la grande presse mena contre ces pratiques une campagne qu’elle n’avait jamais menée contre la torture . Après la conclusion de la paix (18 mars 1962), l’amnistie des « gardiens de l’ordre », le 22 mars et le 14 avril 1962, mit un terme à toutes les poursuites qui pouvaient exister encore dans ce domaine. J’essayai de montrer – et je le pense encore aujourd’hui – que la symétrie avec l’amnistie des crimes des rebelles, en Algérie et en France, était une fausse symétrie. La répression des crimes du FLN avait été réelle. Pour ces crimes, la guillotine avait fonctionné, sans parler de la prison, des camps et de la corvée de bois ; la répression des crimes de l’armée française, en revanche, avait été parfaitement fictive.
La Raison d’État, sortie des presses le 18 avril 1962, mise en librairie début mai, ne se voulait pas une histoire de la répression mais voulait, éperdument, être un livre d’histoire, un recueil de documents commentés sur le ton de l’historien, avec un minimum de sérénité. C’est ainsi que l’interpréta celui qui était alors mon doyen à la faculté des lettres de Lille, Pierre Reboul, militant gaulliste avec qui peu avant, en février, j’avais eu des mots. « Le militant s’efface, habileté suprême, derrière l’historien », m’écrivit-il en mai. On ne peut pas dire que l’accueil du public correspondit à ce jugement. Les comptes rendus furent rares. Seule la revue Partisans, nouvellement fondée par François Maspero, publia un dossier d’ensemble sur le livre. Le Monde, sous la plume d’André Pautard, en parla brièvement, sans souligner le caractère inédit des documents publiés. André Delcroix, c’est-à-dire François Furet, publia dans France-Observateur un compte rendu excellent. Il en fut de même de Tribune socialiste, organe du PSU, le parti qui était en quelque sorte né de la guerre d’Algérie. L’auteur, qui avait gardé l’anonymat, n’était autre que Raymond Lindon, avocat général à la Cour de cassation, père de Jérôme, mon éditeur et mon ami ; pour raison de fonction et pour raison de nom, il pouvait difficilement signer. Quant à L’Express, quelque temps après la parution, il pilla de nombreuses citations issues du livre, sans le citer.
La presse de droite resta muette, qu’elle ait soutenu jusqu’au bout le mythe de l’Algérie française ou qu’elle ait suivi le général de Gaulle en acceptant l’indépendance. Il en fut de même de la presse communiste, et même de la presse algérienne, malgré un appel lancé par Madeleine Rebérioux à Henri Alleg, redevenu directeur d’Alger républicain, pour qu’il présente La Raison d’État au public algérien. Il est vrai qu’aux Algériens son contenu avait peu à apprendre. L’ouvrage fut principalement diffusé par la voie militante, essentiellement par le Comité Maurice Audin qui en avait accepté la responsabilité. Certes, ce n’était pas, et ce n’est toujours pas, un livre de lecture facile. La préface à elle seule comporte plus de cent cinquante notes en bas de page. Je voulais à tout prix assurer mes arrières, comme on dit, et être aussi démonstratif que possible. Je n’avais pas encore appris l’art de raconter. Un éditeur anglais, Dieter Pevsner, de Penguin Books, me demanda, avec l’accord de Jérôme Lindon, de tirer de La Raison d’État un livre narratif pour le public anglo-saxon. Ce fut Torture : Cancer of Democracy, qui sortit des presses pendant les derniers jours de 1962. Ce n’est que dix ans après qu’il y eut une version française de cet ouvrage aux Éditions de Minuit : La Torture dans la République. Un certain réveil s’était manifesté à la suite de la publication en 1971, chez Plon, de La Vraie bataille d’Alger, mémoires du général Massu. Tirée à 3 000 exemplaires, La Raison d’État mit une quinzaine d’années à s’épuiser totalement.
Jérôme Lindon porta un certain nombre de corrections matérielles (principalement des coquilles) sur un exemplaire archivé aux Éditions de Minuit. C’est cet exemplaire à nouveau corrigé par mes soins qui a servi de base à la présente réédition. La seule addition est le nom de Michel Rocard comme auteur du rapport de décembre 1958 sur les camps de regroupement. En 1962, un certain nombre de lecteurs attentifs m’avaient fait observer que l’« autre côté », c’est-à-dire les crimes du FLN, manquait. C’était à la fois vrai et faux. Il suffisait de lire les rapports de la Commission de sauvegarde, celui de Maurice Garçon par exemple, pour s’apercevoir que tout dénonciateur des crimes de l’armée et de la police françaises dans les milieux officiels commençait par rappeler que les gens du FLN égorgeaient, mutilaient, assassinaient par les méthodes les plus variées, non seulement les « colons » et les soldats, mais des Algériens musulmans, qu’ils appartiennent ou non à la mouvance française ou au MNA de Messali Hadj. Cela dit, il est parfaitement vrai que je ne fais alors à ce propos qu’une vague déclaration de principe et que je ne prends pas position sur ce qui a été le crime majeur du FLN, l’extermination de toute la population de Mechta-Kasbah (Melouza) dans la nuit du 19 au 20 mai 1957, sur l’ordre de Mohammedi Saïd, alors responsable de la wilaya 3 (Kabylie), ancien agent nazi et futur ministre du gouvernement algérien.
L’affaire avait fait, sur le moment, grand bruit. Le président de la République, René Coty, fort silencieux devant nos propres crimes, et responsable en dernier ressort de l’exécution des condamnés à mort, avait pris à témoin l’opinion mondiale. Des partisans français de l’indépendance algérienne, comme l’avocat Pierre Stibbe ou le journaliste Robert Barrat, avaient condamné en termes cinglants ce crime abject. Le FLN avait tenté d’allumer un contre-feu en attribuant ce massacre à l’armée française ou à ses auxiliaires algériens. Jacques Vergès, avec son habileté coutumière, avait argué de certains flous dans le récit pour soutenir cette thèse. À moi, il avait formellement déclaré, me laissant quelque peu perplexe : « Melouza était un village FLN. » Ce sont des Algériens qui, lors de l’éclatement du FLN pendant l’été 1962, me dirent sur ce point la vérité. Il est à peine utile de préciser qu’ils n’appartenaient pas au clan qui avait conduit Ben Bella et Boumediene au pouvoir. Pour parler franchement, je ne suis pas de ceux qui ont idéalisé le FLN. Ici ou là, dans Vérité-Liberté, j’ai évoqué ou laissé évoquer (notamment par Claude Bourdet) ses « nombreux crimes », m’attirant quelques engueulades de la part d’hommes dont plusieurs sont demeurés des amis.
Cela dit, s’il est vrai qu’il y avait alors des hommes et des femmes qui pensaient que le FLN était la Révolution incarnée, comme jadis l’avait été l’URSS de Staline jusqu’au grand réveil de 1956, la plupart d’entre eux avaient tendance à garder une discrétion relative sur ces crimes pour plusieurs raisons d’inégale valeur. La première est que, Français, nous étions d’abord comptables de nos crimes. Les Algériens n’étaient français qu’en droit, et ils souhaitaient dans leur majorité cesser de l’être. La deuxième est que le crime colonial était autrement ancien, autrement enraciné que les crimes des colonisés révoltés. Cet argument, à mes yeux d’aujourd’hui, garde sa valeur, à condition, bien entendu, qu’il ne conduise pas au silence ! La troisième raison est que ces crimes faisaient l’objet d’une ample dénonciation de la part des pouvoirs publics : ainsi, lorsque Le Monde publia dans son édition du 14 décembre 1957 le texte intégral du rapport de synthèse de la Commission de sauvegarde, il reproduisit également des extraits d’une brochure publiée par les services de M. Robert Lacoste, ministre résident à Alger, sur les « aspects criminels » de la rébellion algérienne.
La dernière raison est que, tout simplement, nous connaissions très mal l’histoire « intérieure » du FLN et des épurations successives qui avaient marqué son évolution, épurations tout à fait arbitraires et sanguinaires . Seuls ou presque, des hommes comme le cinéaste René Vautier, qui avait vécu de l’intérieur quelques-unes de ces épurations, étaient sans illusions à ce sujet, mais ils ne parlaient pas beaucoup : de même que les « porteurs de valises », comme Francis Jeanson ou Robert Bonnaud, qui connaissaient mieux le FLN, du moins dans sa version française, si j’ose dire, que nombre d’entre nous . Certes, ce qui pouvait se comprendre en 1961 ou 1962 serait impardonnable aujourd’hui. Les historiens se sont mis au travail. Ils ont beau être partagés entre des « sensibilités » diverses, autrement dit avoir des valeurs différentes, certains déplorant que l’intégration de l’Algérie à la République n’ait pas été possible (ainsi Raoul Girardet), d’autres voyant dans la guerre d’Algérie essentiellement une guerre civile (ainsi Guy Pervillé), ils ont beau être français comme Jean-Charles Jauffret, Charles-Robert Ageron, Benjamin Stora ou Gilbert Meynier, ou algériens comme Mohammed Harbi ou Zahir Ihaddaden, ils peuvent coexister et dialoguer entre eux. Ils peuvent même dialoguer à l’intérieur d’eux-mêmes : ainsi Zahir Ihaddaden, dans une contribution à un colloque récent , étudie trois exemples de « désinformation » dans la guerre d’Algérie, la manipulation de l’opinion française sur la réalité de l’insurrection algérienne, la tentative de désinformation du FLN dans l’affaire du massacre de Melouza, et la falsification, par les services français, d’un numéro de l’organe en langue française du FLN, El Moudjahid.
S’agissant de ce qui est au centre de ce livre : la torture d’État et les différentes formes de répression contre l’insurrection algérienne, il est évident qu’avec le double effet du recul et de l’ouverture (relative) des archives publiques et privées, nos connaissances ne pouvaient que se multiplier. Ce n’est pas que la fonction du témoignage ait disparu. Les récits inédits sont innombrables et il est probable que dans les prochaines années, plusieurs d’entre eux seront publiés tandis que d’autres seront utilisés par les historiens. Je donnerai deux exemples récents. Je viens de recevoir un petit livre qui contient, sous la protection d’un pseudonyme, les lettres envoyées aux siens par un jeune appelé entre le 5 juillet 1956 et le 13 juin 1957 . L’authenticité, attestée par plusieurs photos des originaux, ne paraît pas contestable. On trouve dans ces documents non seulement l’apologie de la torture et du massacre comme vengeance, mais tous les poncifs qui pouvaient encourager un jeune soldat, certes d’une intelligence limitée, à persévérer dans la répression la plus violente. « Quel régal de tuer tous ces fumiers dont pas un n’a pu s’échapper. » C’est là une expression assez modérée du quotidien qu’il a vécu et mis en pratique.
À peu près en même temps, je recevais les épreuves du Journal de prison tenu de 1956 à 1962 par un étudiant en médecine, juif algérien et communiste, Daniel Timsit . Impossible, en lisant ces pages réfléchies, d’oublier que tous les « pieds noirs » n’étaient pas les mêmes, qu’un tout petit nombre d’entre eux étaient capables, fût-ce au nom d’un idéal fictif, celui de la société communiste, de s’identifier à la lutte et aux souffrances du peuple algérien. Quelques-uns, au sein de ce peuple, surent accueillir Daniel Timsit. Il fabriqua des explosifs qu’il croyait destinés au maquis. Son nom est cité dans le rapport de synthèse de la Commission de sauvegarde comme ami de Maurice Audin. Il y a plus d’humanité dans ce Journal que dans bien des livres d’histoire écrits par des professionnels. Reste, il est vrai, que des travaux de synthèse ont été rendus possibles par la combinaison adroite de la consultation des archives orales et des sources documentaires écrites. J’ai déjà cité et je cite à nouveau les trois thèses de doctorat dont sont sortis trois livres essentiels, dus à trois jeunes femmes « intrépides » (Robert Bonnaud), faisant irruption dans un monde d’hommes : Claire Mauss-Copeaux, Appelés en Algérie. Une parole confisquée , qui étudie les réactions d’une grosse centaine de soldats originaires de Saint-Dié dans les Vosges, réactions confrontées à ce qu’il était possible de lire dans les archives ; Sylvie Thénault, Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie ; enfin, de Raphaëlle Branche, le livre qui fut comme le point d’orgue de cette série, La Torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie. 1954-1962, issu d’une thèse soutenue à l’Institut d’études politiques le 5 décembre 2000. Le hasard – mais est-ce vraiment un hasard ? – a fait que cette dernière soutenance coïncide avec le retour au plein ciel de l’actualité de la question algérienne absente des débats depuis près de quarante ans.
Ce retour avait été amorcé dans Le Monde daté du 20 juin 2000 par un article de Florence Beaugé donnant la parole à une ancienne victime, Louisette Ighilahriz. Il avait été relancé par la campagne menée au mois d’octobre par Charles Silvestre dans L’Humanité. Le général Massu parla, non plus seulement pour reconnaître, comme il l’avait fait en 1971, mais pour déplorer. Le général Aussaresses vomit plutôt qu’il ne révélât un certain nombre de demi-vérités mêlées de beaucoup de mensonges, acceptant la responsabilité de la mort de Larbi Ben M’Hidi et d’Ali Boumendjel, mais refusant de dire ce qu’il sait de la disparition de Maurice Audin. Son livre fit l’objet d’une poursuite pour apologie de crimes de guerre, les crimes eux-mêmes étant prescrits. Les trois thèses que j’ai mentionnées apportent évidemment beaucoup plus que les révélations d’un général en retraite qui s’est ainsi enrichi. Comment les appelés se sont-ils adaptés à la guerre coloniale ? Comment les magistrats sont-ils passés de l’ordre colonial au désordre militaire ? Comment l’armée a-t-elle, surtout après 1958, fabriqué et multiplié les « services spéciaux » ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles ces livres ont répondu avec succès. Quelle explication donner de ce grand retour ? En quelques lignes, l’historien Mohammed Harbi en a dit plus que bien des livres : « Il y a d’abord eu le travail silencieux des anciens appelés, qui, traumatisés par cette guerre, sont sortis du refoulement, poussés par une nouvelle génération d’historiens. Parallèlement, les archives du Service historique de l’armée de terre se sont ouvertes, des colloques ont été organisés, les journalistes ont travaillé. Des déterminants extérieurs se sont ajoutés, notamment le procès Papon, qui, confrontant la France à la mémoire de Vichy, a buté sur la mémoire algérienne lorsque le rôle de l’ancien préfet de police dans la répression du 17 octobre 1961 a été évoqué. Le fait que les élites politiques responsables des événements aient cédé la place a sans doute aidé ce travail de mémoire . » Fallait-il, dans ces conditions, réimprimer La Raison d’État ? Comme mon ami François Gèze, j’ai cru que cette entreprise avait sa légitimité. Ce livre était un essai d’« histoire immédiate ».
Il est susceptible de montrer aujourd’hui que si, en avril 1962, on ne savait pas tout, on savait déjà beaucoup, si du moins on voulait savoir. Et il peut contribuer à éclairer utilement des controverses hélas toujours contemporaines, comme l’a montré le débat public apparu aux États-Unis après les attentats du 11 septembre, où certains commentateurs n’ont pas hésité à justifier la nécessité de recourir à la torture pour lutter contre le terrorisme, avec le sempiternel argument : « La torture, c’est mal. Mais souvenez-vous : il y a pire. Et dans certaines circonstances, on peut être amené à choisir le moindre des maux . » Je dédie cette préface à Maud Sissung en souvenir du temps où, il y a quarante ans passés, elle « saisissait » dans le plus grand secret les textes qui font l’objet de ce volume.