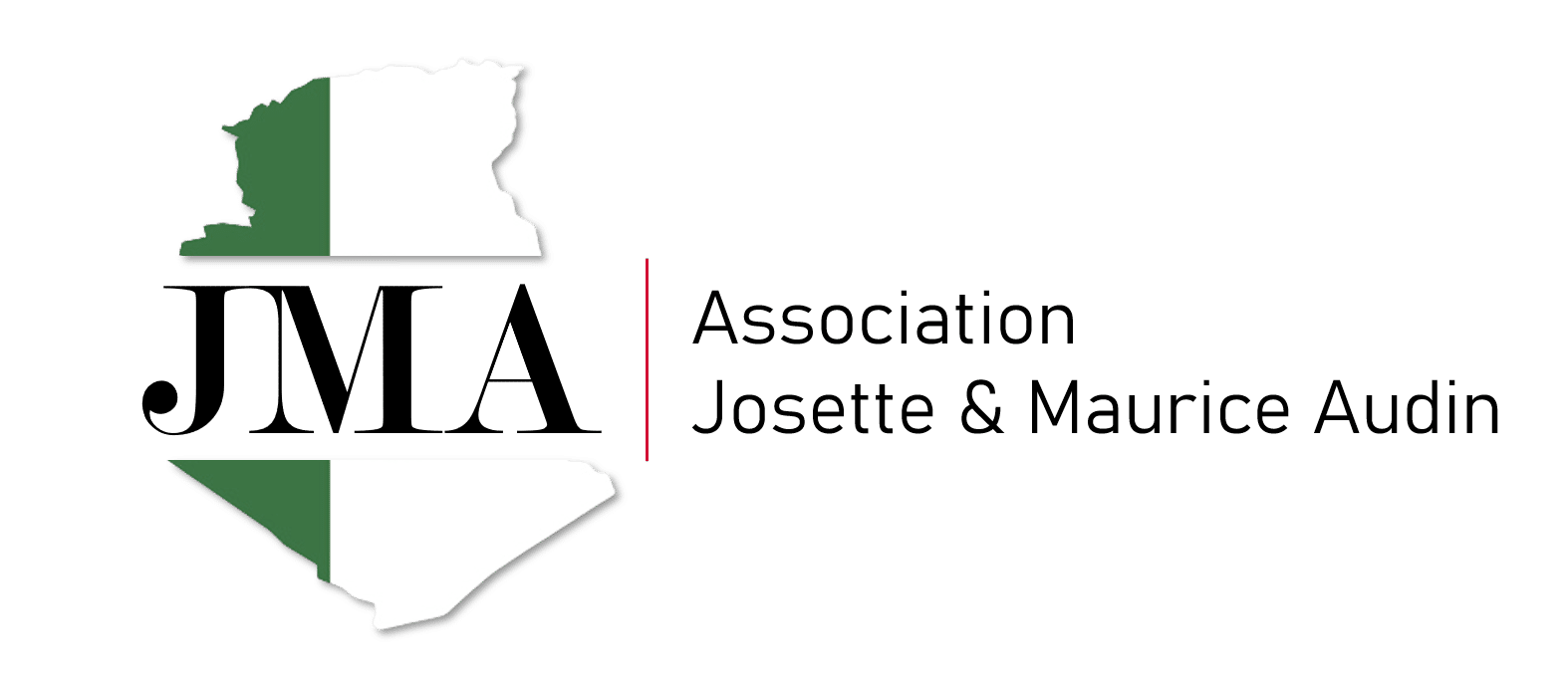Dans un entretien réalisé en 1996, l’historien français, pleinement engagé contre la guerre menée par la France en Algérie, analyse avec recul son engagement d’alors ainsi que le rôle du FLN, la montée de l’islamisme en Algérie, l’image que se font les Français de ce pays, celle des Harkis…
[1]
- En tant qu’historien français engagé
pleinement contre la guerre menée par la France en Algérie, comment, presque 40 ans
après, mesurez-vous la portée de votre engagement et votre prise de position?
Vous faites bien de dire « historien français »
car c’est moins pour l’Algérie que pour la France que j’ai eu mon premier réflexe : on
faisait des choses honteuses pour l’honneur de mon pays ; je devais les combattre. Dans L’affaire
Audin (1958), sur la quatrième de couverture, je republiais un extrait du texte de
Jaurès intitulé Preuves qui démontre les mécanismes de l’affaire Dreyfus. Ma
référence initiale est donc dreyfusarde.
- Avec le recul du temps, connaissant l’évolution politique de l’Algérie indépendante, n’avez-vous pas l’impression d’avoir sous-estimé certains aspects du FLN?
Ce que l’on voit mieux aujourd’hui qu’alors, ce sont deux choses. D’abord, à côté du débat entre indépendance et colonisation qui était
le débat prépondérant, il y en avait un autre qui était un peu masqué et qui portait sur ce que serait l’Algérie future. Serait-elle un Etat qui admettrait les valeurs de l’Occident ou un Etat arabo-islamique? Notre pensée à l’époque aussi bien de gens comme Robert Bonnaud profondément engagé dans l’aide politique que des gens comme moi qui ne
l’était pas, était que plus les « amants français de la liberté » – si je peux m’exprimer ainsi – seraient nombreux à combattre pour la liberté de l’Algérie et plus il y aurait des chances que ces valeurs soient représentées dans l’Algérie nouvelle.
Dès 1962, des inquiétudes sont apparues, notamment à partir de l’affirmation de Ben Bella, débarquant à Tunis : « Nous sommes des Arabes, des Arabes, des Arabes« ,
ce qui était faire litière de la contribution des Kabyles à la libération de l’Algérie qui était quand même une contribution considérable même s’il ne faut pas l’idéaliser et si Amirouche qui était un Kabyle était un des tueurs les plus féroces.
En tout cas, c’était ça notre objectif. Il a été mis à mal par cet arabo-islamisme qui s’est manifesté dès le début de l’indépendance. A propos de l’islamisme qui m’inspirait quelque inquiétude, mais que j’avais minimisé pendant la guerre, Robert Bonnaud me disait à ce moment là : « Ça les aide« .
- Comme forme de mobilisation subjective et culturelle?
Exactement.
- Quel est le deuxième élément « que vous
voyez maintenant »?
C’est la question des femmes. Dès la fin de la guerre, j’ai constaté l’attitude à l’égard des femmes. Ce n’était pas très simple puisque
dans Alger Républicain, quotidien communiste, il y avait un aspect frappant : c’étaient les lettres très nombreuses de femmes dans le courrier des lecteurs. C’était ce qu’il y avait de plus intéressant dans ce journal que j’ai reçu jusqu’à la chute de Ben Bella (en 1965). Puis, il y a eu le livre de Fadela M’Rabet sur les Algériennes. Mais
cela dit, beaucoup de militants algériens n’hésitaient pas à dire – j’ai recueilli des témoignages là-dessus – « Maintenant que nous sommes indépendants, à la niche !«
- Certains disaient que, par l’accès au
travail, elles gagnaient leur autonomie…
Oui, certains étaient pour l’émancipation, au moins
par le travail, mais pas pour le statut personnel…
- Revenons au FLN ; pendant la guerre, n’avait-on
pas une vision dite des « deux temps ». D’abord l’indépendance et il fallait
soutenir cet objectif et cette lutte en priorité, et dans un deuxième temps,
c’est-à-dire, une fois l’indépendance obtenue, on verrait les autres problèmes?
Justement le problème que j’avais soulevé dès
l’époque – ainsi que d’autres comme Edgar Morin – c’était le risque
de remplacer le mythe stalinien par un mythe FLN, de faire une cristallisation de type
stalinien autour du FLN.
- Par un soutien inconditionnel?
Oui, j’étais pour un soutien inconditionnel à la cause
de l’indépendance de l’Algérie, en revanche, le F.L.N. a assez vite suscité en moi
quelques réticences. Mais j’ai sous-estimé au départ, je le reconnais volontiers, sa
nature fondamentalement nationaliste. De ce point de vue, à l’époque, François Furet
avait raison, lorsqu’il rappelait que le FLN était précisément un « front » de
libération nationale avec toutes les limites et les risques que cette appellation
impliquait. Je n’ai pas assez immédiatement vu la structure quasi totalitaire de ce
mouvement même s’il était moins unifié qu’il ne le paraissait puisqu’il éclata dès
1962. En tout cas, sur Melouza (massacre d’un village MNA par le FLN) jamais je n’ai accepté la version de Vergès qui voulait dédouaner le FLN de ce crime et l’attribuer à l’armée française. En fait, j’ai côtoyé l’aide au FLN sans jamais y adhérer. Par contre, j’ai soutenu Boudiaf en 1962 parce qu’il était pour le pluralisme politique.
- Pendant la guerre, il était difficile d’imaginer ou de concevoir une telle division tant l’unité de combat pouvait être considérée comme une nécessité vitale.
Certains, pourtant, le disaient comme Jean Daniel. Roger
Pavet écrivait de Tunis à ses amis de L’Observateur que l’Algérie indépendante commencerait dans le chaos.
- Et à propos de l’islamisme politique aujourd’hui en Algérie ?
Pendant la soutenance de la thèse de Djamila Amrane sur
Les femmes algériennes dans la guerre, qui est publiée chez Plon avec une préface que j’ai rédigée, je n’ai cessé de lui dire : « Vous minimisez la dimension islamique du combat algérien« , et elle ne cessa de me répondre que je surestimais cet aspect des choses. En particulier, lorsque dans tous les témoignages qu’elle recueillait, il était question « d’Allah, que son nom soit béni« ,
il ne s’agissait pour elle que d’une simple formule rituelle qui n’avait pas beaucoup d’importance.
- Est-ce que vous-même ne l’avez pas minimisé pendant la guerre?
Pendant la guerre, je l’ai certainement minimisé un peu trop. En tout cas dès 1962, j’ai compris que je l’avais minimisée et en 1975, au moment de cette thèse, il était absolument clair pour moi que c’était quelque chose de capital.
- Aujourd’hui, l’opinion française vit mal cette réalité algérienne là…
Elle le vit mal parce que la société politique française s’imagine qu’en soutenant le gouvernement algérien, qui est une dictature
militaire, on aidera les Algériens à se débarrasser des islamistes. Je ne pense rien de cela. Au cours de l’été 1993, j’ai publié dans Libération un article pour dire à peu près sur les positions de San Egidio où je disais qu’il n’était absolument pas question de soutenir le pouvoir actuel et que, des deux côtés dans cette guerre civile, on
employait des moyens absolument abominables.
- D’une manière plus globale, comment voyez-vous l’évolution de l’attitude de la société française à travers ses médias (presse,
institution scolaire mais aussi classe politique) ?
D’une manière générale la société française vit
mal l’Algérie car elle a chez elle des Algériens qu’elle n’intègre qu’à demi (voir les
Harkis) bien qu’il y ait une intégration réelle de beaucoup de beurs. Il n’y a qu’à
écouter Radio Beur de temps en temps pour s’en apercevoir. Mais la situation reste
compliquée par le fait qu’on a transformé la lutte en Algérie de 1954 à 1962 en une
lutte contre l’immigration dont Monsieur Le Pen est le triste héros. Que le héros de
cette lutte soit un ancien tortionnaire de la guerre d’Algérie ce n’est pas innocent. Il
y a là une symbolique très forte. D’autant plus que cette immigration a beaucoup
augmenté depuis 1962 et que certains sont tentés de dire : ils ont eu leur indépendance,
qu’est-ce qu’ils viennent faire chez nous?
- Est ce que la présence des pieds-noirs en
France entretient cette image?
Certainement, je le vois par la correspondance que je
reçois de temps à autre de pieds noirs exaspérés
- Et la question des Harkis?
Je suis le seul à être intervenu dès 1962, par un
article dans Le Monde [2] intitulé « La guerre
révolutionnaire et la tragédie des Harkis » et dont je ne regrette pas un mot. Je
l’avais conclu ainsi : « Les résistants algériens ont sans doute le droit de
mépriser les Harkis, et de les tenir pour des traîtres ; le gouvernement français ne l’a
pas, et il est d’ailleurs trop évident que ces hommes, même ceux qui ont commis, sur
ordre, des crimes, sont des victimes autant que des coupables, des victimes de l’ordre
colonial.
Nous ne nous faisons pas trop d’illusions sur la portée de cet appel, mais ce scandale
doit cesser. C’est en France que les anciens Harkis et leur famille peuvent être sauvés,
c’est en France que pourront se trouver les militants algériens, moins marqués par la
répression qu’en Algérie, malgré ce qu’ils ont subi eux aussi, capables d’entreprendre
la rééducation nécessaire. On a pu concevoir que les Harkis risquaient de devenir une
masse de manœuvre entre les mains d’officiers OAS ; cette crainte n’a plus guère de
sens aujourd’hui. D’ailleurs, il appartient aux Français et aux Algériens de France, et
notamment aux militants ouvriers, de faire en sorte que cette crainte soit vaine.
Les Harkis n’ont en tout cas pas à payer pour nos fautes. Bien qu’on tende aujourd’hui à
l’oublier, la guerre d’Algérie a eu lieu. »
- Revenons sur la façon dont l’enseignement de
l’Histoire en France se fait à propos de l’Algérie…
Pour l’enseignement, je constate que la plupart des
manuels parlent de la torture pendant la guerre d’Algérie en se référant soit à mes
propres travaux ou à La question d’Henri Alleg. Il ne faut pas charger les
professeurs de tous les péchés d’Israël !
- Et la classe politique?
Elle n’est pas brillante. Mais quand même, on voit une
certaine évolution, un certain mouvement de renouvellement dans la mesure où beaucoup
d’anciens dirigeants du PSU qui se sont formés pendant la lutte contre la guerre
d’Algérie, y compris un homme comme Jospin, ont encadré le nouveau P.S. Mais cela n’a
pas empêché Charles Hernu, de triste mémoire, de me refuser le dossier du ministère de
la Défense sur l’affaire Audin. Alors que Robert Badinter m’a donné ce dossier pour le
ministère de la Justice, et j’y ai trouvé beaucoup de nouveautés que j’ai publiées
dans mon ouvrage sur cette affaire [3].
- De ce point de vue, quelles sont, selon vous,
les conséquences pour la société française des différentes amnisties, depuis les
accords d’Evian jusqu’à celle de 1982 ?
Honteuses, honteuses, en particulier pour la prise de
conscience de la société française. Le fait qu’il n’y ait pas eu un seul procès de
tortionnaires français est une honte. Cela a joué un rôle néfaste. Ainsi pour
l’affaire Audin, une loi ad hoc a été votée parce que nous avions objecté que
cette affaire n’était pas une affaire de maintien de l’ordre, mais une affaire de police
judiciaire ; ils ont donc fait une nouvelle amnistie pour y inclure les affaires de police
judiciaire. A ce moment-là la Cour de Cassation a rendu son arrêt…
- Et l’amnistie de 1982 ?
Une honte contre laquelle j’ai protesté dans une lettre
avec Laurent Schwartz, publiée dans Le Monde.
- Pourquoi François Mitterrand en a-t-il
décidé ainsi?
Mitterrand a toujours cherché cet électorat-là. Ce
fut déjà le cas en 1965 par rapport à l’électorat de Tixier Vignancourt.
- On sent une continuité quelque part…
Tout à fait. Bien que pendant la guerre d’Algérie,
pendant qu’il était ministre de la Justice en 1956-57, il ait été moins mauvais qu’on
ne le dit. Il n’avait à son affaire que la justice civile et Reliquet (le procureur
général à Alger et qui était un libéral) a dit devant moi que jamais il n’avait reçu
d’instructions aussi fermes contre la torture que celles qu’il avait reçues de
Mitterrand.
- Et cela avait de l’effet?
Aucun.
- Est ce qu’il savait que cela n’avait pas
d’effet?
C’est le problème !
- Et alors quelle démarche proposez-vous pour
aborder comme citoyen français, mais aussi comme historien, la situation algérienne et
le rapport entre la France et l’Algérie de manière rationnelle?
C’est très difficile parce que cela ne relève plus de
notre ressort. En revanche, de même que Che Guevara disait que le devoir d’un
révolutionnaire c’est de faire la révolution, je dirai que le devoir d’un historien
c’est de faire de l’histoire. Et là, il n’y en a pas beaucoup. Un des seuls à faire de
l’Histoire en profondeur c’est Mohamed Harbi et sur ce point, il mérite tout notre
soutien. J’ajouterai aussi un homme comme Gilbert Meynier qui lui aussi fait
véritablement de l’Histoire. Il y a là un problème, mais je ne me sens pas à la
hauteur du drame.
- Comme historien, vous avez l’impression qu’il
n’y a pas suffisamment de volonté ou de capacité à s’engager dans ce travail?
Il y en a quelques-uns quand même que je peux ajouter,
il y a Annie Rey Goldzeiguer, il y a Benjamin Stora, il y a aussi Guy Pervillé, qui même si c’est un homme qui regrette que nous ayons perdu l’Algérie, est un historien professionnel, qui connaît bien l’Algérie.
Entretien conduit par Bernard Ravenel
[1] Cet entretien a été publié dans Confluences Méditerranée N°19, Automne 1996.
[2] Le Monde du 11-12 novembre 1962.
[3] Pierre Vidal-Naquet : L’affaire Audin (1957 – 1978). Editions de Minuit, Paris 1989.